Télécharger le programme détaillé (PDF)
Télécharger le flyer de la conférence (PDF)
Formulaire d’inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnZqW6gh2
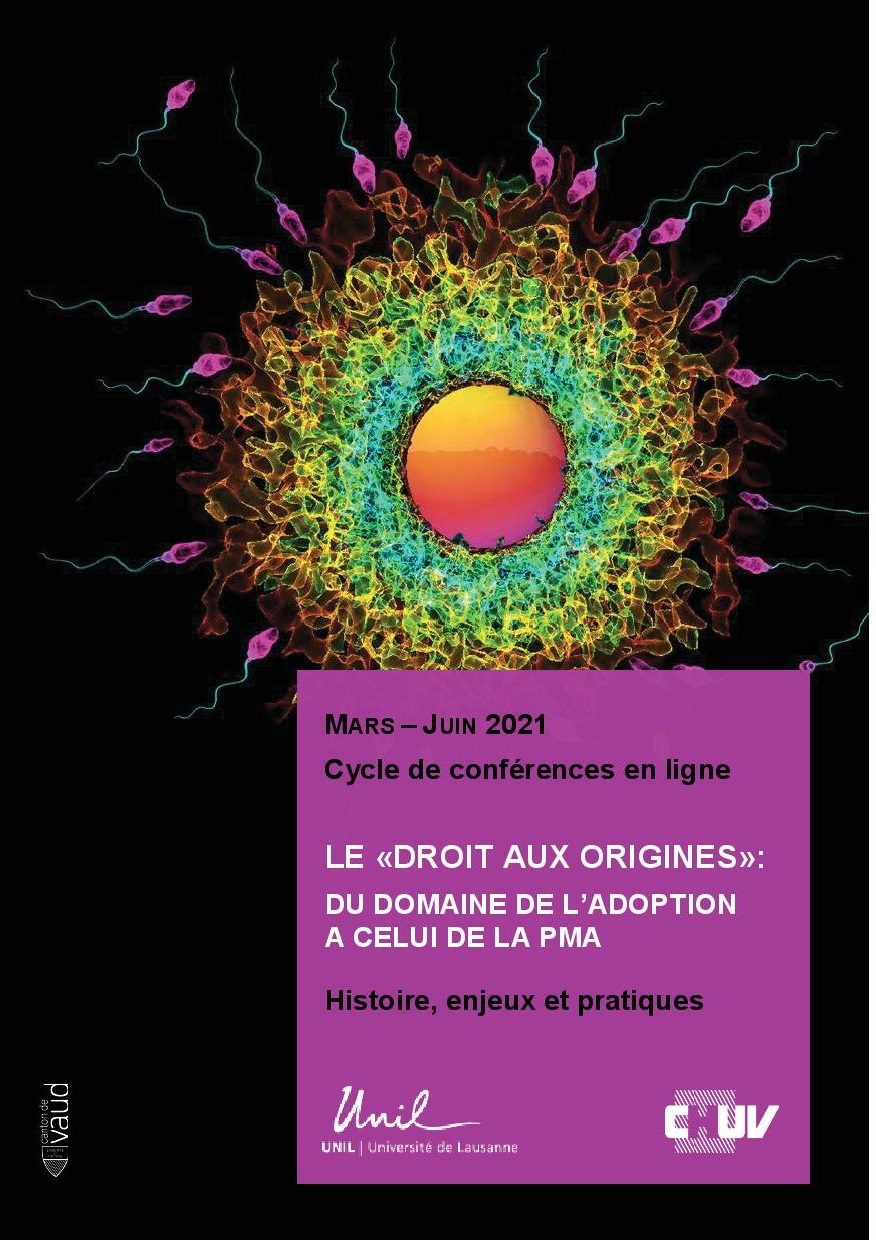

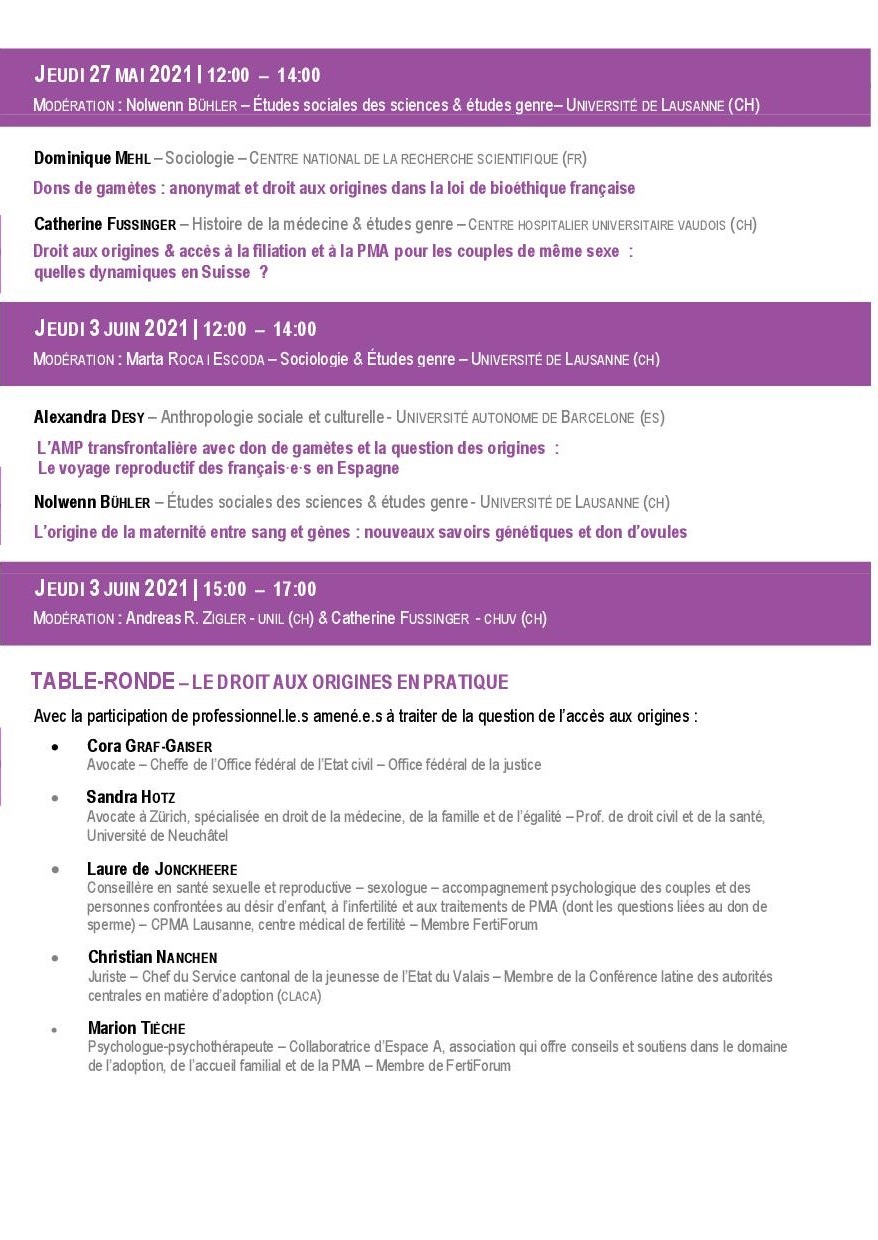
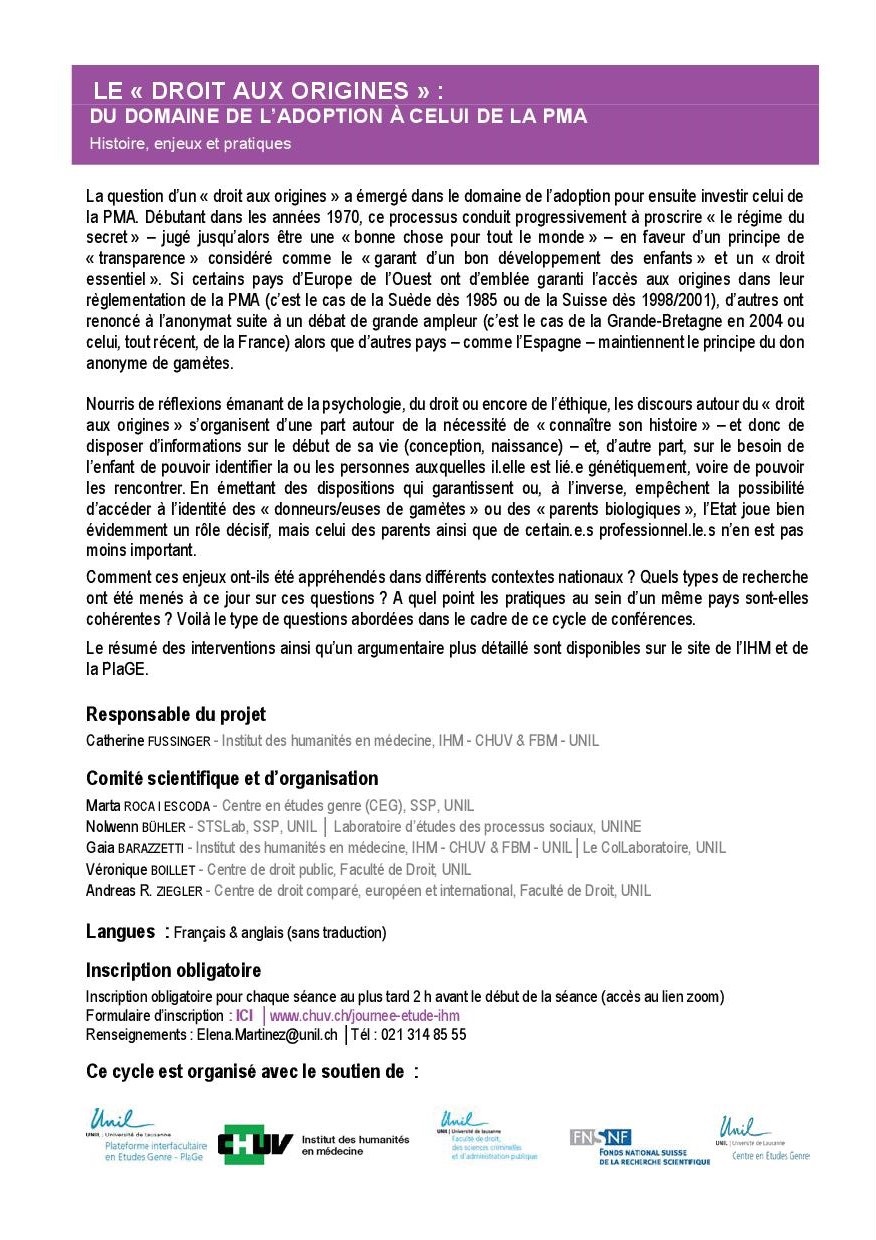

Télécharger le programme détaillé (PDF)
Télécharger le flyer de la conférence (PDF)
Formulaire d’inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnZqW6gh2
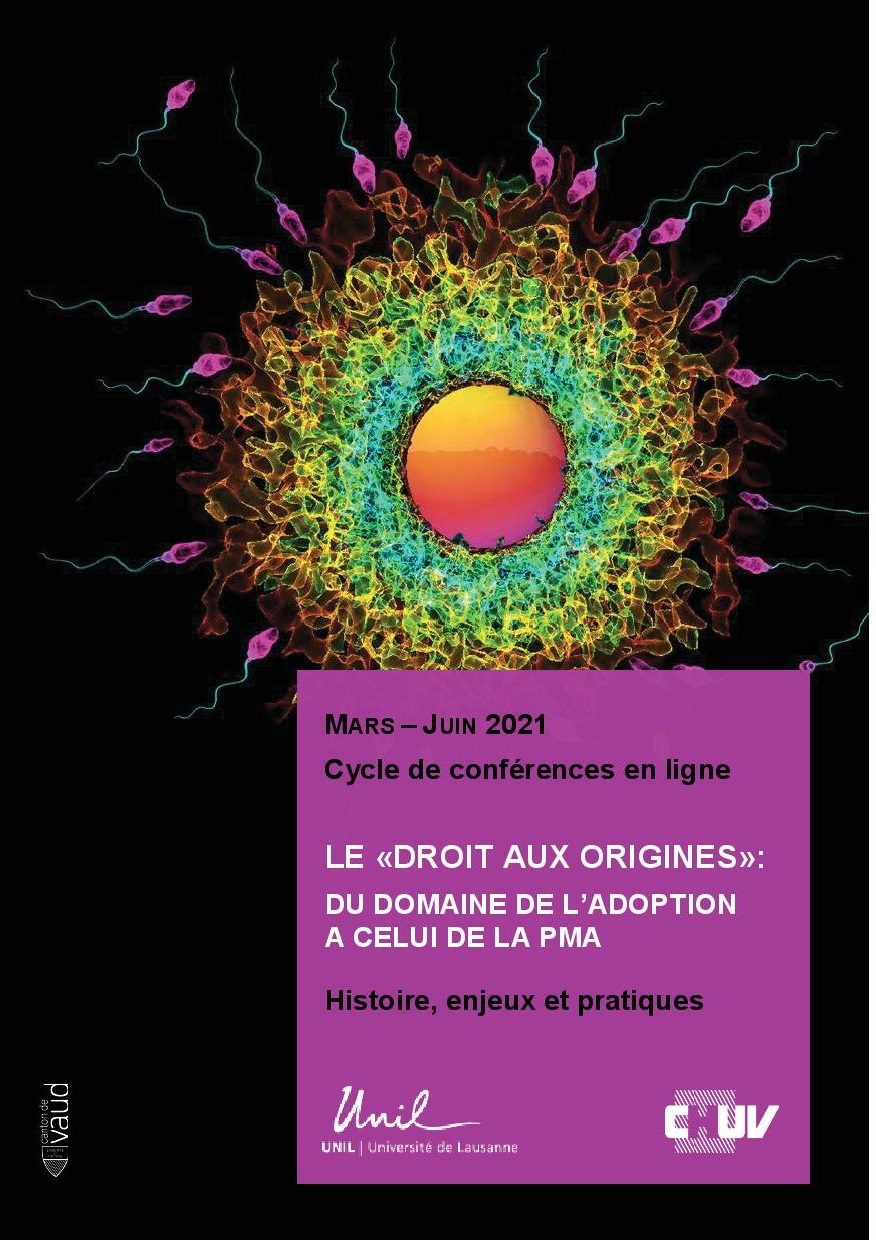

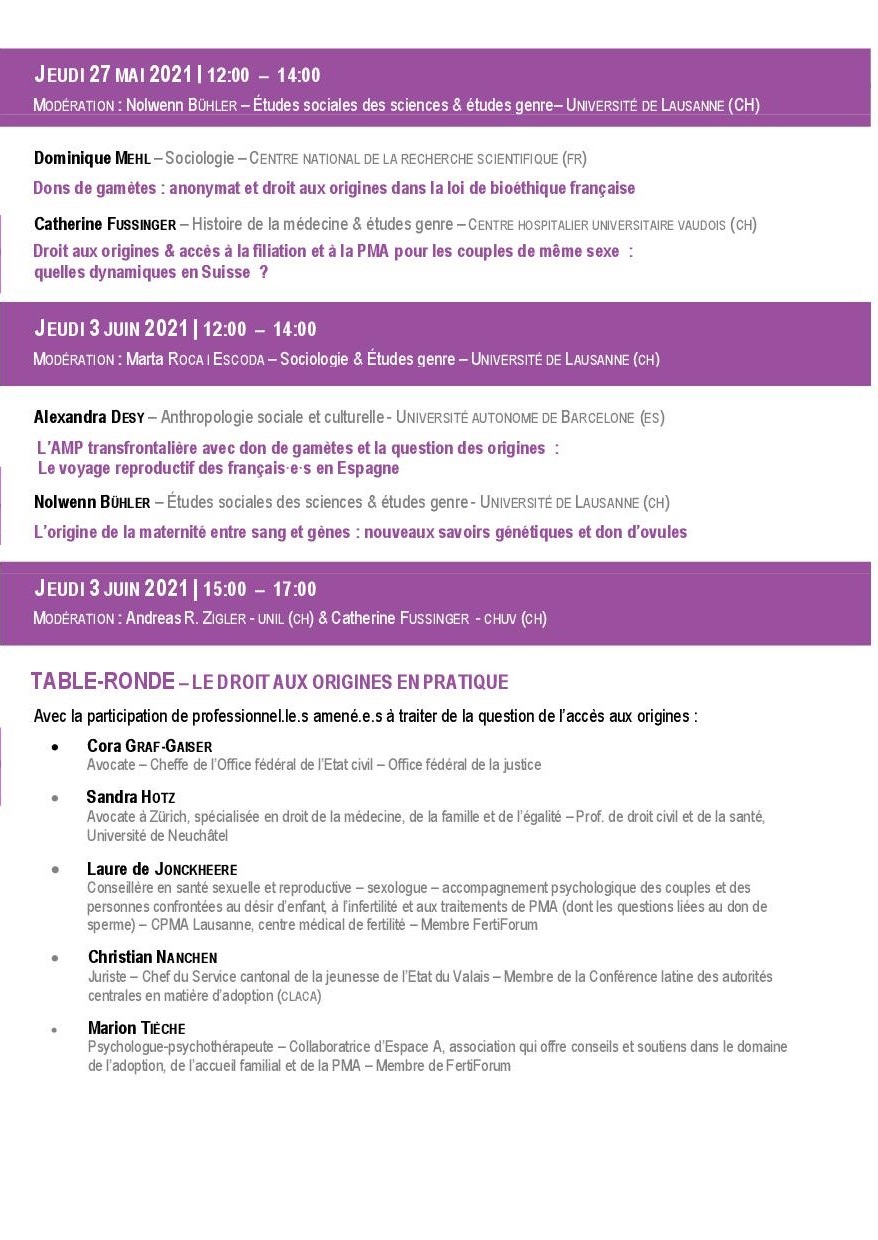
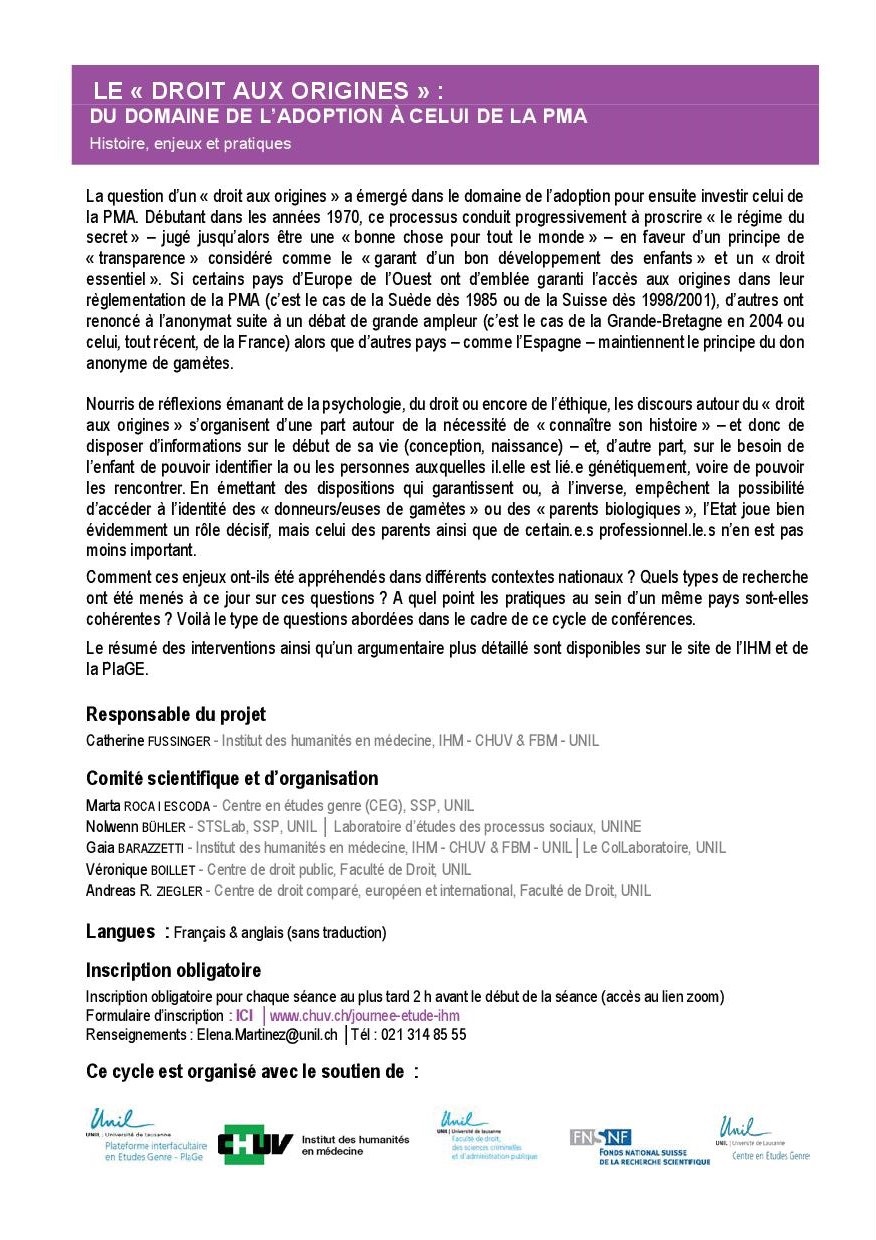
L’association Dons de gamètes solidaires est reconnue depuis le mois de février 2021 comme étant d’intérêt général.
Auteurs : Alain Ducousso-Lacaze
Date de mise en ligne : 2014
Résumé :
L’évolution du rapport de nos sociétés à l’homosexualité interroge-t-elle nos conceptions psychanalytiques de l’homosexualité ? L’auteur explore cette question à partir de recherches cliniques sur l’homoparentalité. Une autre est soulevée : l’étude de l’homoparentalité interroge-t-elle les conceptions psychanalytiques de la famille ? Les recherches cliniques ne remettent pas en question la psychanalyse dans ses fondements théoriques et cliniques mais questionnent ce que ses conceptions théoriques de l’homosexualité et de la famille doivent aux normes sociales d’une époque. L’étude de cas proposée illustre comment, dans le couple homosexuel, la différence sexuelle peut être à l’œuvre, comment les enjeux œdipiens peuvent être réactualisés par l’accès à la parentalité, comment la bisexualité psychique sous-tend la construction du lien de couple et à l’enfant.
Plan :
Le couple homosexuel et la différence sexuelle
Le devenir parent et la réactualisation des enjeux œdipiens
Le choix de la conception et les liens intergénérationnels
Le lien au donneur
Conclure ?
Citation : Ducousso-Lacaze Alain, « Questions pour la clinique psychanalytique à partir d’une situation d’homoparentalité », Dialogue, 2014/1 (n° 203), p. 15-27. DOI : 10.3917/dia.203.0015. URL : https://www.cairn.info/revue-dialogue-2014-1-page-15.htm
Lien du document : : https://www.cairn.info/revue-dialogue-2014-1-page-15.htm
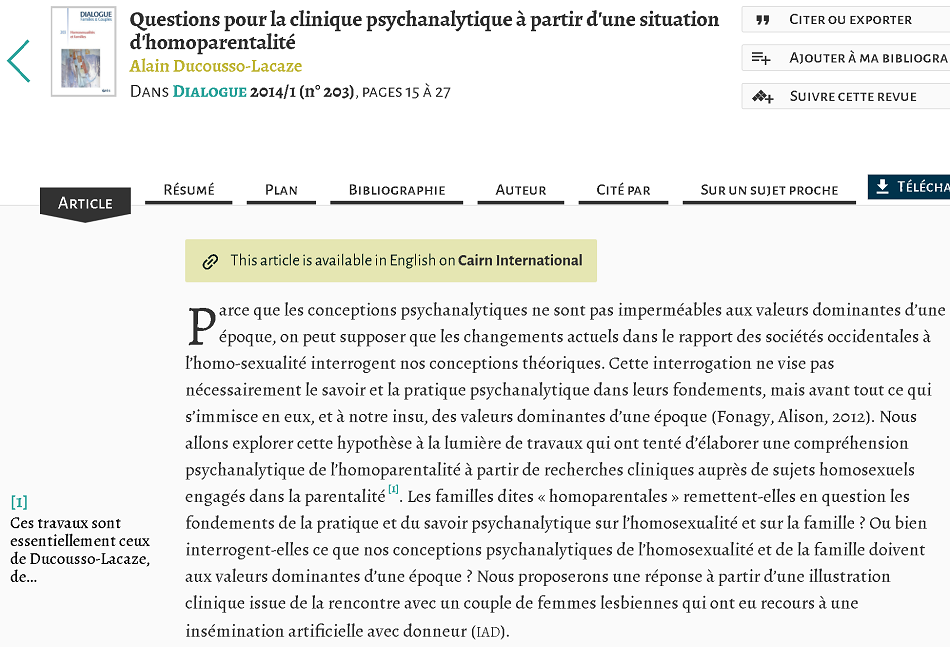
Extraits :
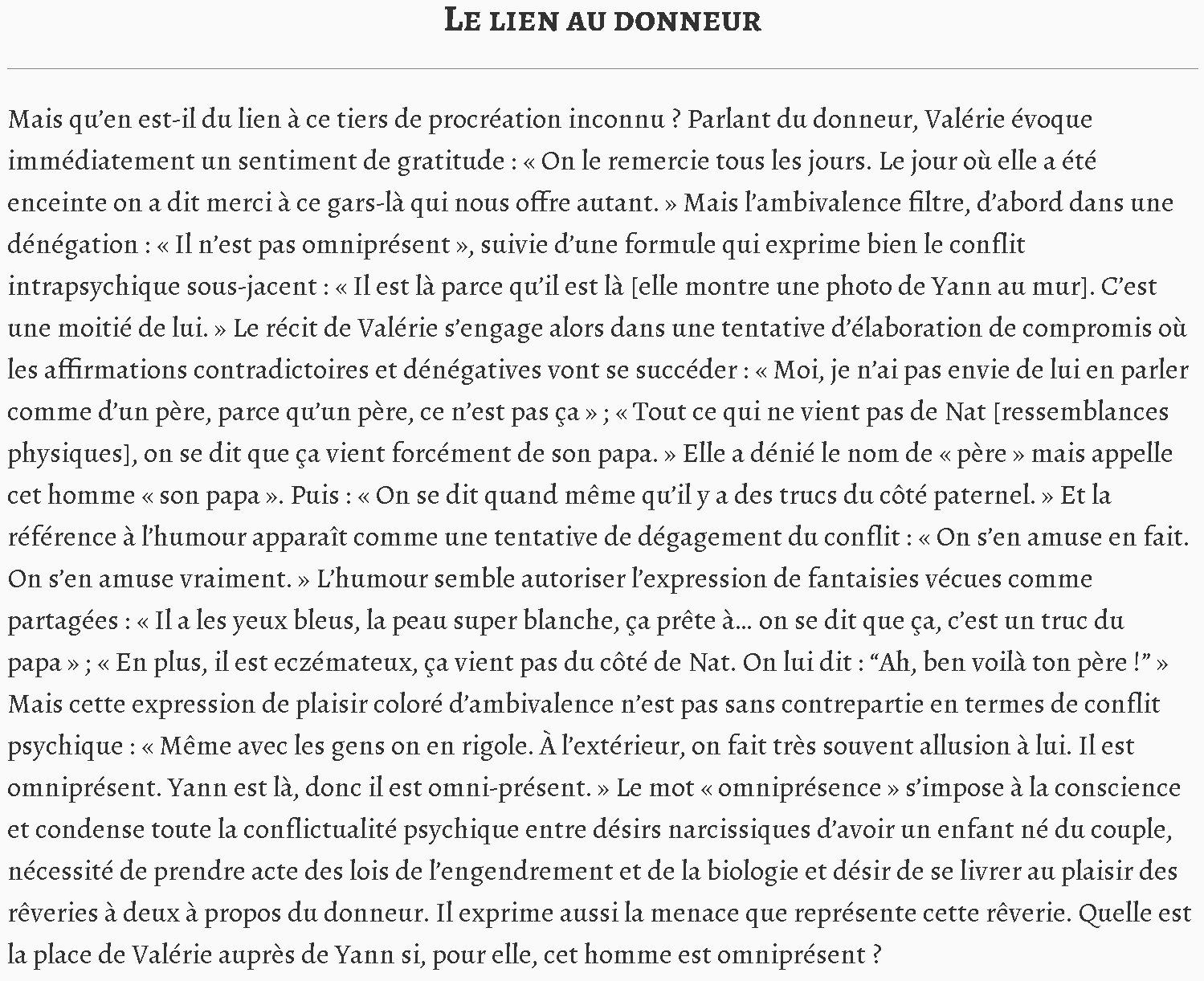
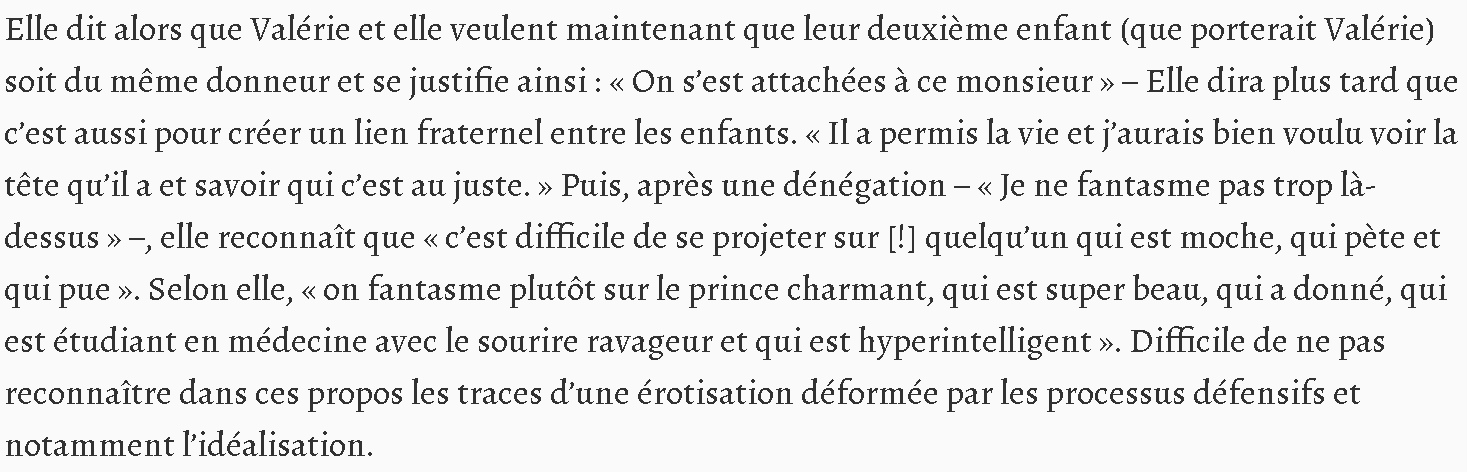
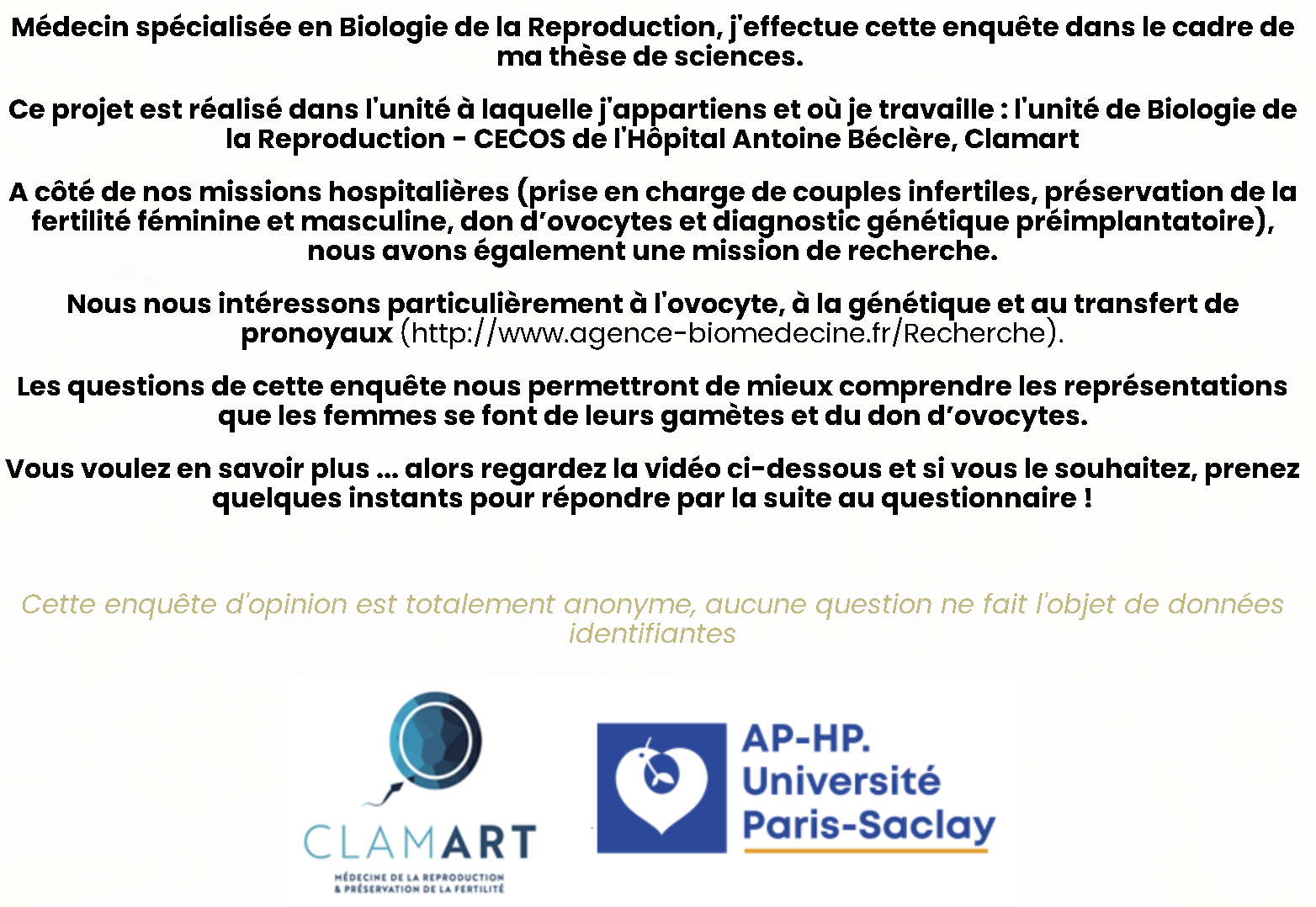
Lien vers l’enquête : https://form.dragnsurvey.com/survey/r/bb8af67c
—
Je recopie le courrier parlant de cette enquête.
Chèr(e) collègue(s), chèr(e)s ami(e)s,
Nous effectuons actuellement une enquête concernant le don d’ovocytes et plus précisément sur la place dans l’intellect féminin de l’importance de la transmission génétique. Ce questionnaire intègre notamment des questions sur la thématique du transfert de pronoyaux : une donneuse d’ovocyte serait-elle plus encline à donner sachant que son ADN (nucléaire) ne serait pas transmis ? A l’inverse, une receveuse serait-elle plus encline à recevoir sachant qu’il s’agit « uniquement » d’un don de cytoplasme ?
Nous vous serions extrêmement reconnaissant si vous vouliez bien répondre au questionnaire :
Via le lien internet suivant :
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/bb8af67c
Ou via le QR code ci-dessous

L’Objectif est bien entendu… d’obtenir un maximum de répondants ! Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à diffuser le lien via vos réseaux sociaux.
Cette enquête est totalement anonyme, aucune donnée n’est identifiante et aucune donnée sensible n’est recueillie. L’adresse IP du répondant n’est pas enregistrée.
En vous remerciant de l’aide que vous nous apportez
Amitiés,
L’unité de Biologie de la Reproduction-CECOS d’Antoine Béclère

Auteurs : Éva Weil
Date de mise en ligne : 2019
Résumé
L’enfant en vient maintenant à s’occuper du premier, du grand problème de la vie et se pose la question : d’où viennent les enfants ? […] Que l’enfant croisse dans le corps de la mère n’est manifestement pas une explication suffisante. Comment y entre-t‑il ? Qu’est ce qui déclenche son développement ? Que le père y soit pour quelque chose est vraisemblable ; il dit bien que l’enfant est aussi son enfant (Freud S., 1908c, p. 17 et 21).
Ces premières questions des enfants soulevées par la curiosité concernant le gros ventre de la mère, ou d’une autre femme, semblent être le moteur de toute recherche intellectuelle, qui va trouver là un lieu d’expérimentation sous couvert d’avancée scientifique persistant à l’âge adulte.
Mon expérience clinique, déjà longue, dans les services de médecine de la reproduction de l’APHP m’a amené à rencontrer des patients qui veulent un enfant et se voient confrontés à la nécessité de recourir à un don de gamètes, d’embryon et peut-être bientôt à une greffe d’utérus. Ils nous confrontent à la question, posée plus haut et toujours actuelle : « d’où viennent les enfants ? » qui concerne aussi les patients fertiles faisant don de leurs gamètes, de leurs embryons cryoconservés. Les équipes médicales demandent à ces patients fertiles, sous couvert des lois et circulaires, d’exposer leurs motivations, en particulier, la nature de ce qui est donné. Ceci laissera entier, pour tous, le mystère de la création de l’humain.
Un couple peut demander un don de gamètes, nécessairement anonyme, en France actuellement, quelquefois, non anonyme dans certains pays d’Europe tout près, et aux États-Unis…
Citation : Weil Éva, « Maternité par procréation médicalement assistée : mais d’où viennent les enfants ? », dans : Hélène Parat éd., Maternités. Paris cedex 14, Presses Universitaires de France, « Débats en psychanalyse », 2019, p. 115-129. URL : https://www.cairn.info/maternites–9782130786986-page-115.htm
Lien du document : : https://www.cairn.info/maternites–9782130786986-page-115.htm
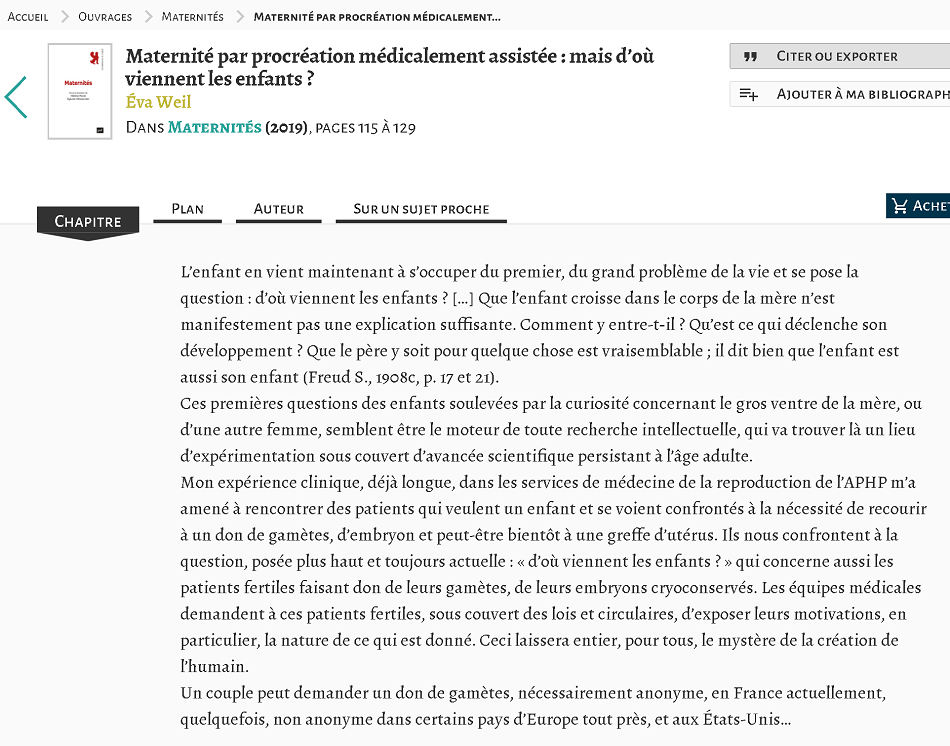
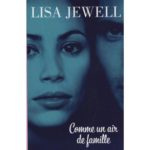 Lydia est une richissime scientifique solitaire de vingt-neuf ans, Robyn une belle et prometteuse étudiante en médecine et Dean un très jeune père, déjà veuf et un peu dépassé. Ils n’ont a priori rien en commun, si ce n’est… leurs gènes ! Issus du même don de sperme, ils ont grandi se croyant seuls au monde et se découvrent soudain une fratrie. Chacun, à un tournant de sa vie, va se plonger dans une bouleversante quête d’identité. Un donneur de sperme, sur le point de mourir, souhaite savoir ce que sont devenus les enfants issus de ses dons.
Lydia est une richissime scientifique solitaire de vingt-neuf ans, Robyn une belle et prometteuse étudiante en médecine et Dean un très jeune père, déjà veuf et un peu dépassé. Ils n’ont a priori rien en commun, si ce n’est… leurs gènes ! Issus du même don de sperme, ils ont grandi se croyant seuls au monde et se découvrent soudain une fratrie. Chacun, à un tournant de sa vie, va se plonger dans une bouleversante quête d’identité. Un donneur de sperme, sur le point de mourir, souhaite savoir ce que sont devenus les enfants issus de ses dons.
Ce livre est paru précédemment sous le titre : « Quatre naissances et un enterrement »
Informations bibliographiques
Éditeur : FRANCE LOISIRS
Auteur : Lisa Jewell
Parution : 2012
Nb. de pages : 544 pages
EAN : 9782298059441
ISBN : 2298059446
Auteurs : Agnès Condat (1,2), Grégor Mamou (3), Chrystelle Lagrange (1), Nicolas Mendes (1,4), Joy Wielart (1), Fanny Poirier (1), François Medjkane (5), Julie Brunelle (1), Véronique Drouineaud (4), Ouriel Rosenblum (1,4), Nouria Gründler (1,4), François Ansermet (6), Jean-Philippe Wolf (4,7), Bruno Falissard (8), David Cohen (1,9)
1) Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, Hôpital Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Paris, France,
2) CESP INSERM 1018, ED3C, Université Paris Descartes, Paris, France,
3) Clinique Dupré , Fondation Santé des Etudiants de France, Sceaux, France,
4) Service Biologie de la Reproduction–CECOS, Hôpital Cochin, AP-HP, Paris, France,
5) Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, CHU de Lille, Lille, France,
6) Service de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Département de l’enfant et de l’adolescent, Hôpitaux Universitaires de Genève, Geneva, Switzerland,
7) Université Paris Descartes, Paris, France,
8) Inserm, U669, Paris, France, 9 Institut des Systèmes Intelligents et de Robotiques, Université Pierre et Marie Curie, Paris, France
Date de mise en ligne : 19 novembre 2020
Résumé
Medical advances in assisted reproductive technology have created new ways for transgender persons to become parents outside the context of adoption. The limited empirical data does not support the idea that trans-parenthood negatively impacts children’s development. However, the question has led to lively societal debates making the need for evidence-based studies urgent. We aimed to compare cognitive development, mental health, gender identity, quality of life and family dynamics using standardized instruments and experimental protocols in 32 children who were conceived by donor sperm insemination (DSI) in French couples with a cisgender woman and a transgender man, the transition occurring before conception. We constituted two control groups matched for age, gender and family status. We found no significant difference between groups regarding cognitive development, mental health, and gender identity, meaning that neither the transgender fatherhood nor the use of DSI had any impact on these characteristics. The results of the descriptive analysis showed positive psycho-emotional development. Additionally, when we asked raters to differentiate the family drawings of the group of children of trans-fathers from those who were naturally conceived, no rater was able to differentiate the groups above chance levels, meaning that what children expressed through family drawing did not indicate cues related to trans-fatherhood. However, when we assessed mothers and fathers with the Five-Minute Speech Sample, we found that the emotions expressed by transgender fathers were higher than those of cisgender fathers who conceived by sex or by DSI. We conclude that the first empirical data regarding child development in the context of trans-parenthood are reassuring. We believe that this research will also improve transgender couple care and that of their children in a society where access to care remains difficult in this population. However, further research is needed with adolescents and young adults.
Mots clés : Assistance médicale à la procréation, Pédopsychiatrie, Centre médico-psychologique, Parentalité, Développement psychologique
Citation : Condat A, Mamou G, Lagrange C, Mendes N, Wielart J, Poirier F, et al. (2020) Transgender fathering: Children’s psychological and family outcomes. PLoS ONE 15(11): e0241214. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241214
Lien du document : : https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241214
Licence : : Copyright: © 2020 Condat et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
Nous revenons dans une semaine.
Portez vous bien et à bientôt !
La présidente de la Fédération Française des CECOS estime que le financement présenté par l’agence de la biomédecine pour accompagner la PMA pour toutes n’est pas acceptable en raison de son montant insuffisant et de son caractère non reconductible.
Nous soutenons toutes les demandes visant à augmenter le financement des activités d’AMP.
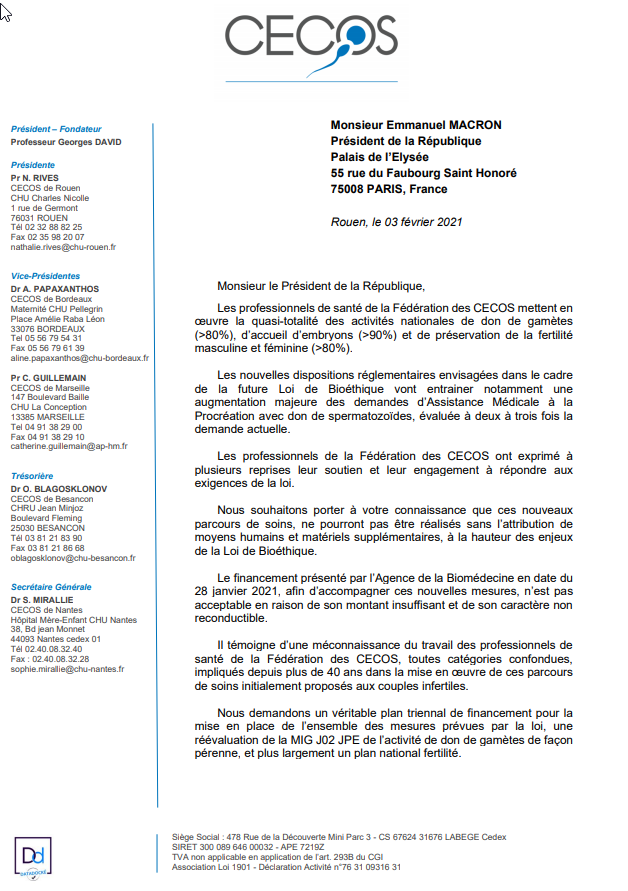
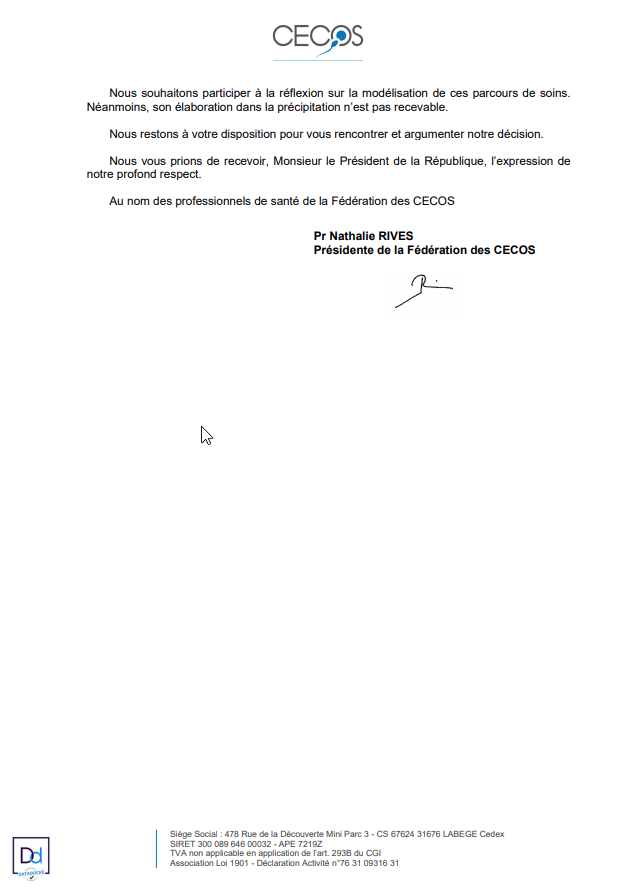
—
Le sénateur Yves Détraigne a lui aussi adressé un courrier dans lequel, il s’inquiète des moyens financiers nécessaires pour la PMA pour toutes.
Lien : https://www.senateur-detraigne.org/moyens-financiers-et-humains-dans-les-cecos/
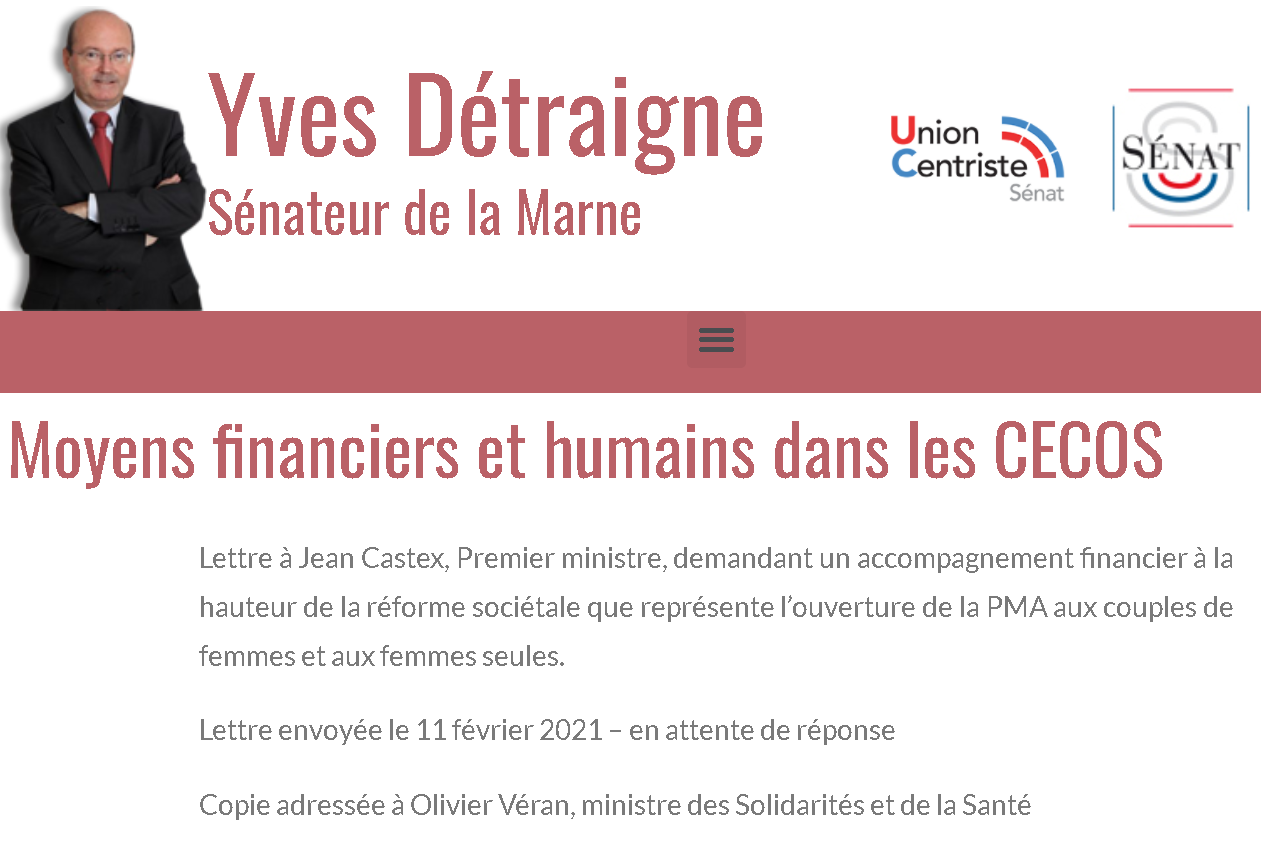
Le Dr de Vienne, médecin référent AMP a présenté le 25 septembre 2020, lors du dernier congrès de la FFER, les missions de l’Agence de la Biomédecine.
Lien pour voir toutes les vidéos du congrès de la FFER : http://ffer-clermont2020.avinit.tv
Séquence consacrée à l’anonymat du don de gamètes.