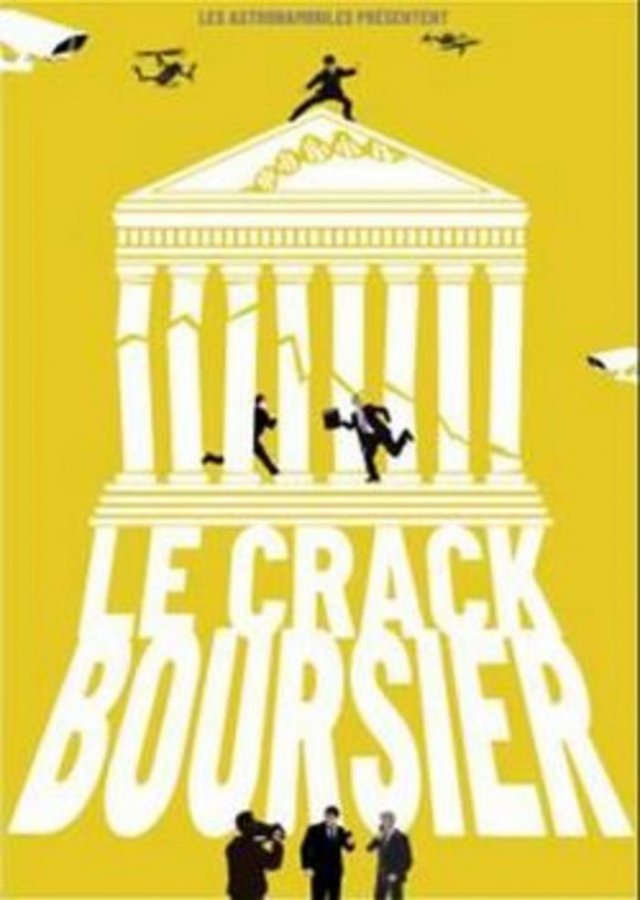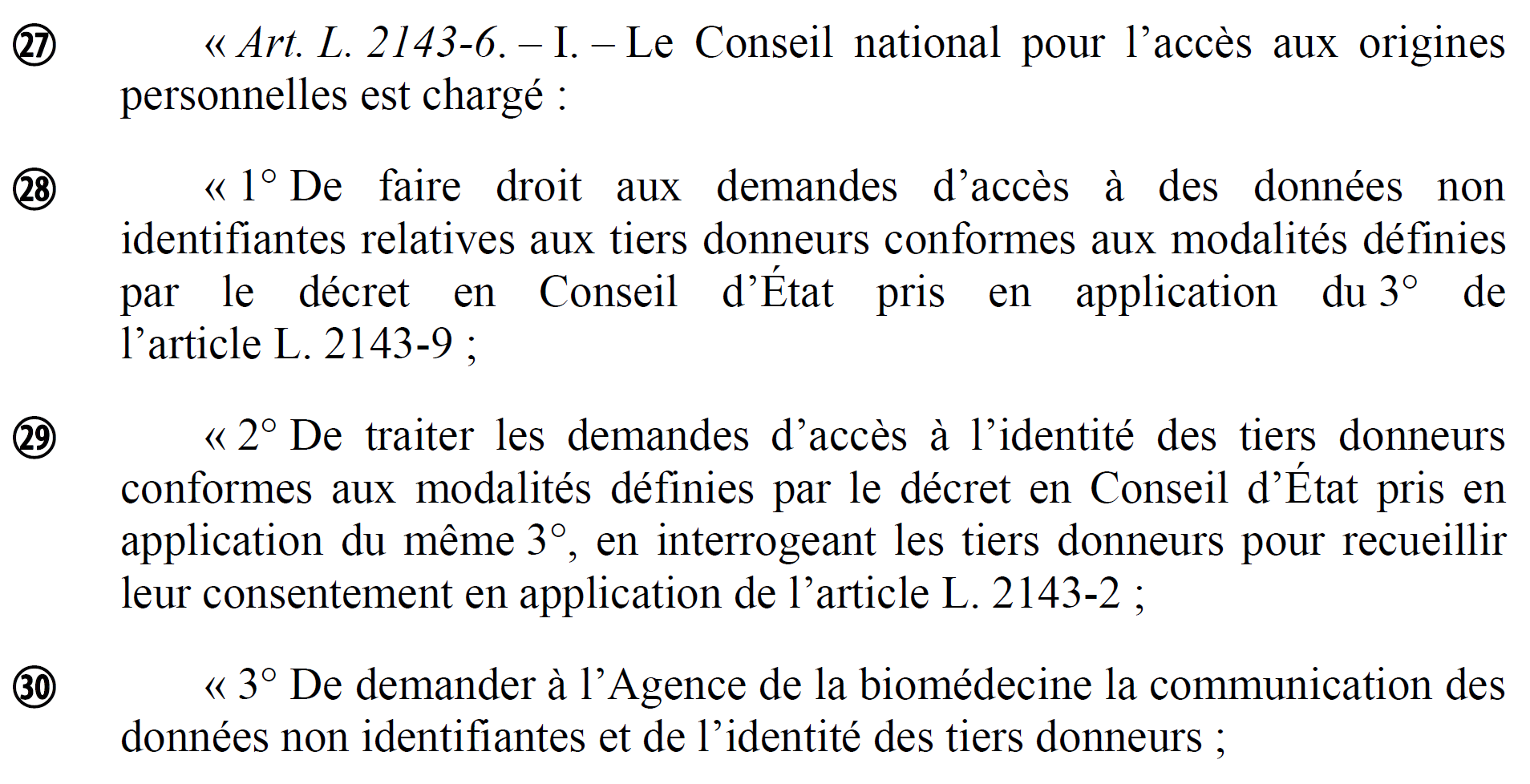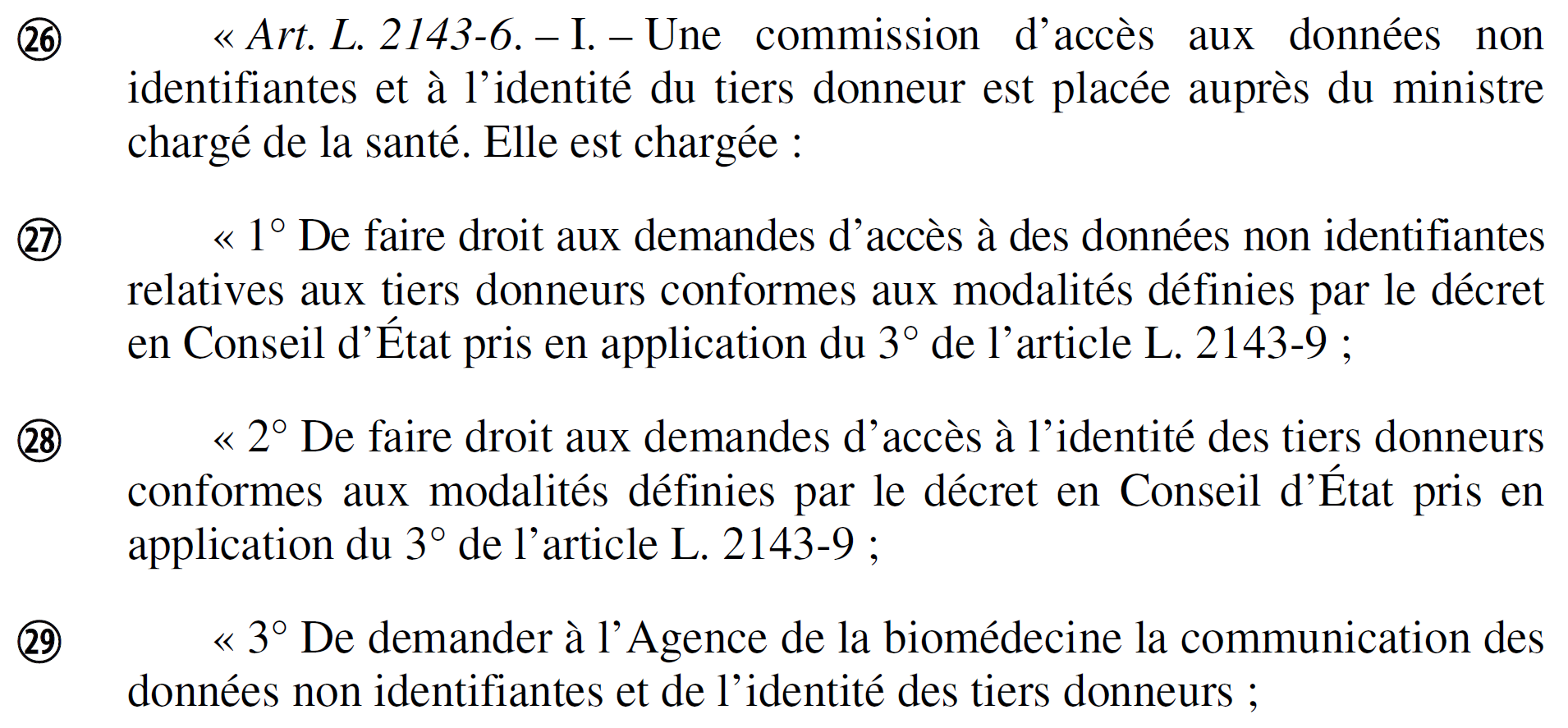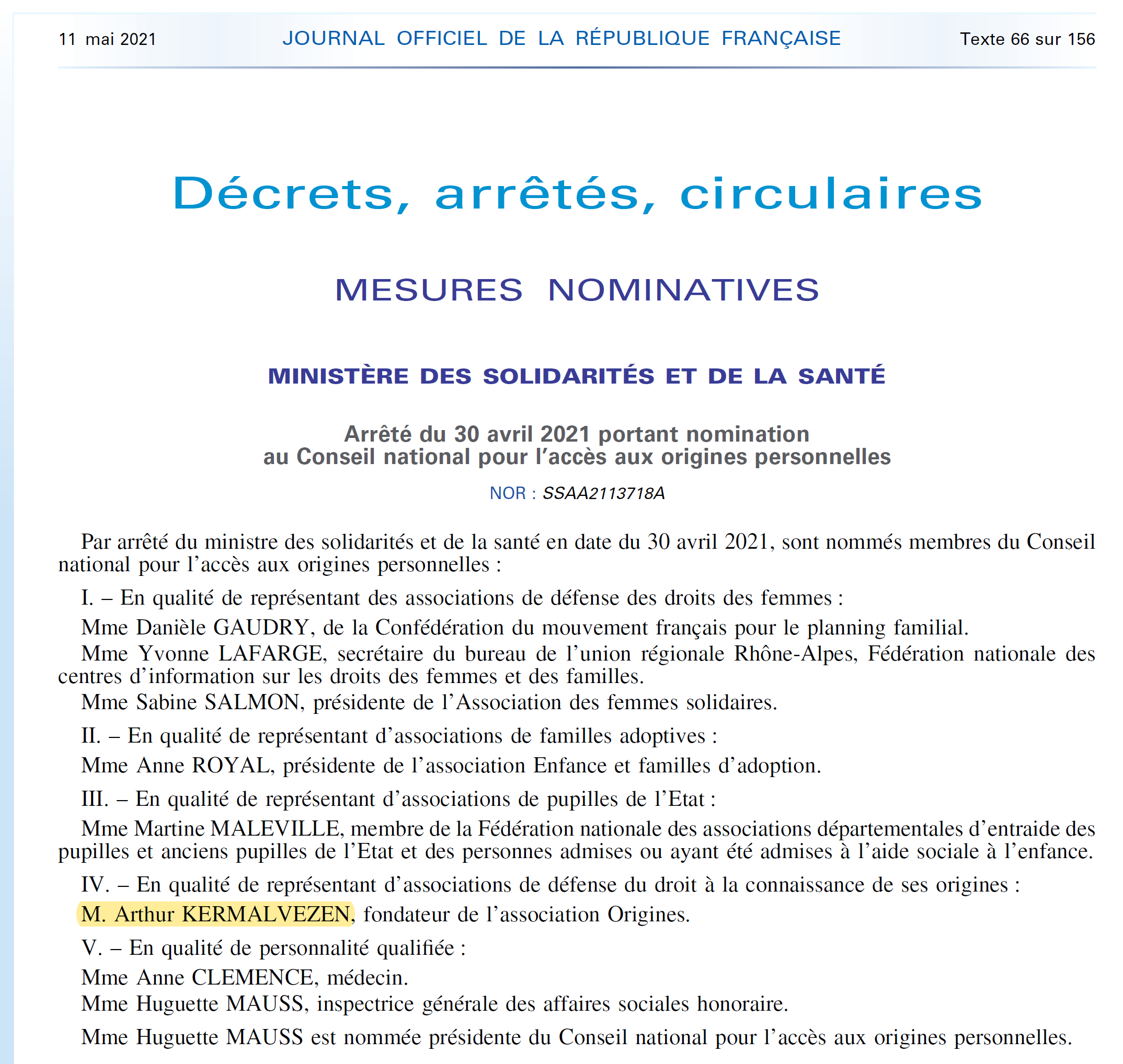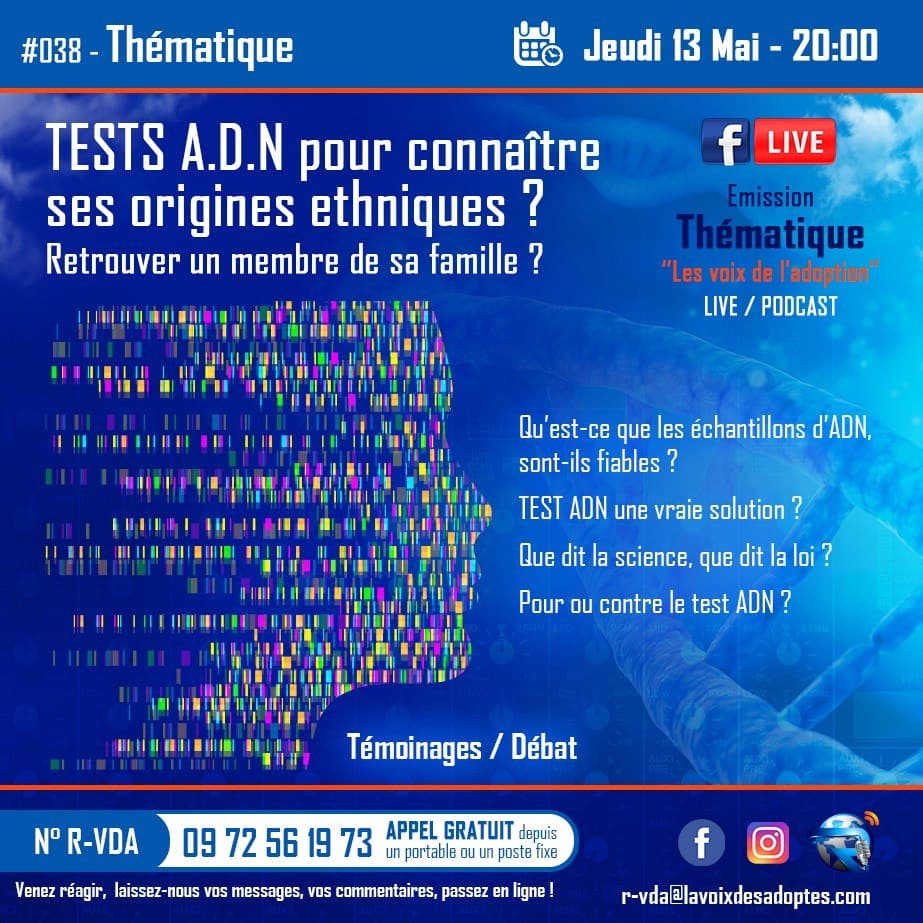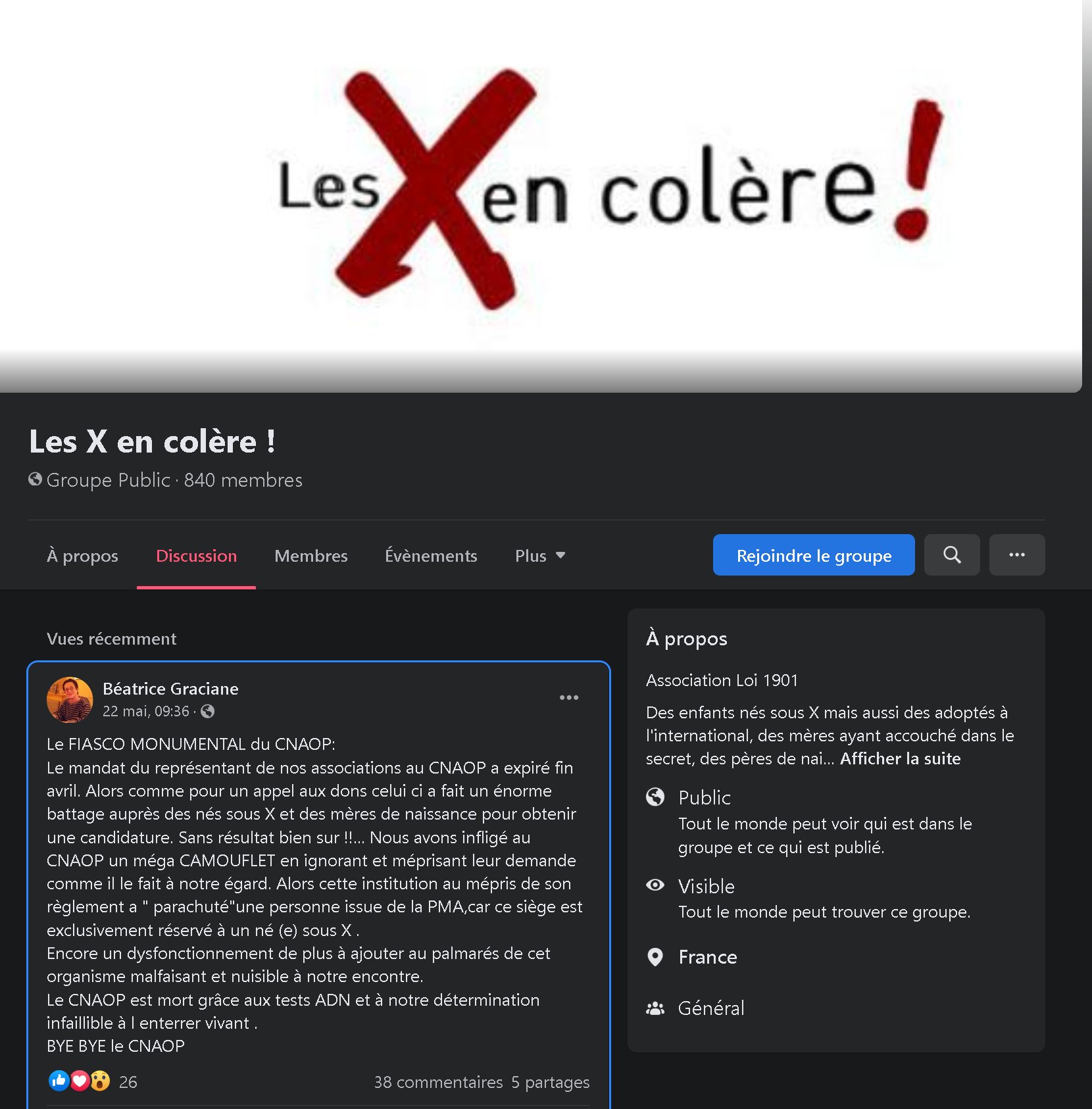1844 amendements ont été mis en ligne.
Lien pour consulter le dossier législatif :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/bioethique_2
Compte rendu du 1er juin 2021 à 21h (PDF)
Compte rendu du 2 juin 2021 à 9h (PDF)
Compte rendu du 2 juin 2021 à 15h (PDF)
Compte rendu du 2 juin 2021 à 21h (PDF)
Compte rendu du 3 juin 2021 à 9h (PDF)
Article 1
Amendement 1536 qui souhaite que des parents qui ont abandonné un enfant car celui-ci avait un handicap, ne puissent pas bénéficier d’un parcours AMP. Idem pour l’amendement 1590.
Amendement 1561 qui prend en compte la situation où l’embryon donné a été conçu grâce à un don de gamètes. Idem pour l’amendement 1615.
Amendement 958 qui s’interroge sur les critères d’appariement du donneur. Idem pour l’amendement 1576. Idem pour l’amendement 1630.
Amendement 397 qui s’interroge sur les critères d’appariement du donneur. Idem pour l’amendement 398. Idem pour l’amendement 603.
Amendement 748 qui souhaite interdire l’appariement délibéré du groupe sanguin.
Amendement 747 qui souhaite inscrire dans la loi la limite de 2 dons pour les donneuses d’ovocytes.
Article 2
Amendement 1775 pour ne pas concevoir délibérément des enfants avec les gamètes d’un donneur décédé. Idem pour l’amendement 1720. Idem pour l’amendement 1738. Idem pour l’amendement 1802.
Amendement 1730 qui prévoit que si une personne a bénéficié d’une autoconservation de ses gamètes, ceux-ci ne puissent pas servir à concevoir des enfants après son décès. Idem pour l’amendement 1748. Idem pour l’amendement 1812. Idem pour l’amendement 1761.
Amendement 1792 qui prévoit que les donneurs puissent savoir si leur don a permis au moins une naissance. Idem pour l’amendement 880. Idem pour l’amendement 537.
Amendement 1796 qui prévoit que les donneurs soient informés quand leurs données personnelles sont transmises aux enfants.
Amendement 1718 demandant que les donneurs soient informés de l’existence d’associations susceptibles de les aider. Idem pour l’amendement 1736. Idem pour l’amendement 1801.
Amendements visant à conserver l’obligation d’obtenir au moment du don, le consentement du conjoint quand le donneur est en couple. Refus du rapporteur qui estime que cette obligation qui existe depuis 1994 a pour conséquence de rechercher tous futurs partenaires du donneur et ses enfants, afin de les informer de l’existence du don.
Amendements 1721 interdisant l’autoconservation gratuite des gamètes en échange d’un don. Idem pour l’amendement 1739. Idem pour l’amendement 1803.
Article 3
La rapporteure Coralie Dubost explique que les personnes issues d’un don ne sont pas à la recherche d’un demi-frère ou d’une demi-sœur.
Amendement 124 visant à faciliter l’accès aux données médicales par le médecin d’une personne issue d’un don. Idem pour l’amendement 257. Idem pour l’amendement 1225. Idem pour l’amendement 1286. Idem pour l’amendement 1818. Idem pour l’Amendement 3. Idem pour l’amendement 609.
Amendement 751 qui précise que les données « non identifiantes » peuvent de manière indirectes être identifiantes.
Amendement 622 destiné à permettre aux donneurs d’avoir accès à leurs propres données médicales.
Amendement 750 destiné à permettre au personnel médical suivant une grossesse issue d’un don d’ovocytes, d’avoir connaissance de l’âge de la donneuse.
Amendement 619 destiné à ce que les donneuses d’ovocytes ne puissent faire qu’un seul don.
Amendement 611 permettant à l’agence de la biomédecine d’avoir accès au fichier national des donneurs. Idem pour l’amendement 142. Idem pour l’amendement 275. Idem pour l’amendement 965. Idem pour l’amendement 903. Idem pour l’amendement 647. Idem pour l’amendement 1239. Idem pour l’amendement 1299. Idem pour l’amendement 1829. Idem pour l’amendement 1238. Idem pour l’amendement 1253. Idem pour l’amendement 1254. Idem pour l’amendement 1298.
Amendement 563 destiné à limiter la durée de conservation des gamètes. Idem pour l’amendement 566.
Amendement 535 destiné à supprimer le consentement du conjoint du donneur.
Amendement 91 destiné à imposer le consentement du conjoint du donneur. Idem pour l’amendement 796. Idem pour l’amendement 131. Idem pour l’amendement 264. Idem pour l’amendement 636. Idem pour l’amendement 155. Idem pour l’amendement 287. Idem pour l’amendement 970. Idem pour l’amendement 659.
Amendement 854 demande le consentement des 2 membres ayant fait don d’embryons.
Amendement 788 destiné à limiter le don aux seules personnes ayant déjà eu un enfant.
Amendement 614 prévoit que les dons des anciens donneurs ne peuvent servir pour des femmes célibataires qu’avec l’accord des anciens donneurs. Idem pour l’amendement 615. Idem pour l’amendement 913. Idem pour l’amendement 565. Idem pour l’amendement 568. Idem pour l’amendement 1302. Idem pour l’amendement 1242.
Amendement 858 prévoit que l’enfant issu d’un don puisse accéder aux données non identifiantes du donneur avant sa majorité. Idem pour l’amendement 857. Idem pour l’amendement 856. Idem pour l’amendement 792. Idem pour l’amendement 482. Idem pour l’amendement 789. Idem pour l’amendement 855. Idem pour l’amendement 483. Idem pour l’amendement 484.
Amendement 754 permet que les donneurs soient informés quand leurs données personnelles sont communiquées aux personnes issues du don. Idem pour l’amendement 616.
Amendement 894 permet au donneur de donner son numéro de sécurité sociale pour être retrouvé plus aisément. Idem pour l’amendement 895. Idem pour l’amendement 485. Idem pour l’amendement 612. Idem pour l’amendement 613. Idem pour l’amendement 749. Idem pour l’amendement 564. Idem pour l’amendement 567. Idem pour l’amendement 1244. Idem pour l’amendement 1303. Idem pour l’amendement 1832. Idem pour l’amendement 1212.
Amendement 1233 qui indique que les données non identifiantes sont uniquement destinées aux enfants. Idem pour l’amendement 1294. Idem pour l’amendement 1826. Idem pour l’amendement 909. Idem pour l’amendement 910.
Amendement 753 permettant au donneur si son don a permis au moins une naissance.
Amendement 758 qui prévoit que quand la donneuse d’ovocytes ne transmet pas son ADN à l’enfant, alors, le don reste anonyme.
Amendement 625 ayant pour objectif que les parents d’enfants issus d’un don ne connaissent pas la profession du donneur.
Amendement 752 vise à permettre aux donneurs d’avoir accès à leurs propres données personnelles figurant dans leur dossier CECOS.
Amendement 756 vise à améliorer les informations données aux donneurs.
Amendement 624 qui prévoit que dès que les enfants issus d’un don sont majeurs, leurs parents n’ont plus accès aux données non identifiantes du donneur.
Amendement 755 visant à améliorer les droits des donneurs dans le cas de la rétroactivité.
Amendement 757 permettant à la commission de statuer sur des situations exceptionnelles.
Amendement 146 prévoyant que la commission dispose d’au moins un membre représentant les donneurs. Idem pour l’amendement 279. Idem pour l’amendement 147. Idem pour l’amendement 280. Idem pour l’amendement 651. Idem pour l’amendement 652. Idem pour l’amendement 922. Idem pour l’Amendement 1474.
Amendement 1246 qui prévoit que pour levé l’anonymat des anciens donneurs, il faut l’accord des conjoints. Idem pour l’amendement 1305. Idem pour l’amendement 1793. Idem pour l’amendement 1797. Idem pour l’amendement 1795. Idem pour l’amendement 1799. Idem pour l’amendement 1836. Idem pour l’amendement 1794. Idem pour l’amendement 1798. Idem pour l’amendement 1835. Idem pour l’amendement 1485. Idem pour l’amendement 617.
Amendement 1438 qui précise que pour les anciens donneurs d’embryons, il faut l’accord des donneurs pour levé l’anonymat.
Amendement 1394 qui modifie la donnée non identifiante « état général ». Idem pour l’amendement 1248.
Amendement 1862 pour connaître le nombre d’enfants issus du don.
Amendement 1463 pour adoucir la rédaction du texte qui est parfois un peu brutale envers les donneurs. La rapporteure parle de démarchage concernant le fait de recontacter les anciens donneurs.
Amendement 1247 prévoyant que les personnes issues d’un don pourront à leur majorité obtenir l’état de santé du donneur au moment de son don. Idem pour l’amendement 486. Idem pour l’amendement 48.
Amendement 140 qui indique que les données non identifiantes sont uniquement destinées aux enfants. Idem pour l’amendement 273. Idem pour l’amendement 645.
Amendement 487 qui prévoit que les donneurs pourront bénéficier d’une assistance de la part de la commission en charge de l’accès aux origines.
La rapporteure Coralie Dubost déclare que les statistiques sont très claires sur le fait que 30% des enfants en France n’ont pas de lien génétique avec leur père.
Article 4
Amendement 811 destiné à permettre aux personnes issues d’un don de connaître l’identité du donneur à tout âge. Idem pour l’amendement 814.
Amendement 100 qui vise à permettre un lien de filiation entre l’enfant et le donneur. Idem pour l’amendement 443. Idem pour l’amendement 577. Idem pour l’amendement 1647. Idem pour l’amendement 1781. Idem pour l’amendement 1786. Idem pour l’amendement 1858.