Quand la pratique du don de spermatozoïdes a commencé à se développer, des sociologues ont mené une réflexion sur le sujet et ces travaux ont abouti à la conclusion que le vrai père de l’enfant est le père d’intention. C’est à dire que le « père » est l’homme qui désire l’enfant et qui l’élève. Il est donc possible d’être le père d’un enfant en l’absence de tout lien biologique.
Cependant, la loi française était en retard sur les sciences sociales, puisqu’elle considérait que le père d’un enfant est celui qui a donné le spermatozoïde à l’origine de la conception de l’enfant. Cela avait pour conséquence que le lien de filiation entre le père d’intention et son enfant issu d’un don était fragile et pouvait être désavoué.
Dans les années 70/80/90, l’accompagnement psychologique des couples en parcours AMP avec tiers donneur était souvent insuffisant, ce qui fait que certains couples vivaient mal ce don et pouvaient se séparer peu de temps après la naissance de l’enfant. Des pères pouvaient considérer que leur enfant n’était pas leur enfant du fait de l’absence de lien biologique, et c’est la raison pour laquelle, ils saisissaient la justice pour demander un désaveu de paternité. Dès 1976 (jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nice, le 30 juin 1976), on trouve dans les journaux des articles consacrés à ces désaveux de paternité pour des enfants issus d’une AMP avec tiers donneur. A ma connaissance, les tribunaux ont toujours validé les désaveux de paternité pour les enfants issus d’un don ayant moins d’un an.
Afin de remédier à ces situations, il a été décidé en 1994 de voter les premières lois de bioéthique encadrant la pratique de l’AMP exogène. Il a été décidé que la filiation des enfants issus d’une AMP avec tiers donneur ne pouvait pas être contestée. Il a également été décidé qu’aucun lien de filiation ne pouvait être établi entre le donneur et l’enfant issu de son don.
Code civil, article 311-20, alinéa 2 :
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet.
Code civil, article 311-19 :
En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.
La loi de bioéthique de 1994 reprenait en grande partie les règles établies par les CECOS. C’est à dire que le don se faisait entre « un couple donneur fertile » (le couple devait avoir au moins un enfant) et « un couple infertile ». Le don de gamètes était strictement anonyme.
2. La situation en 2020
Nous sommes aujourd’hui en 2020 et la situation n’est plus la même qu’en 1994.
La première différence est l’existence des tests génétiques qui peuvent permettre à une personne issue d’un don de retrouver le donneur.
La deuxième différence, c’est que la notion de « couple donneur » n’est plus utilisée et on parle uniquement du donneur. Depuis 2015, pour être donneur, il n’est plus nécessaire d’être en couple, ni d’avoir au moins un enfant.
La troisième différence est que l’actuel projet de loi bioéthique va prochainement ouvrir la PMA aux femmes célibataires. C’est à dire que des enfants auront une filiation établie uniquement avec leur mère.
La quatrième différence est que l’actuel projet de loi bioéthique va prochainement instaurer un droit d’accès aux origines, ce qui signifie que les personnes issues d’un don pourront connaître l’identité du donneur.
La question que nous souhaitons poser dans cet article, c’est s’il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir en toutes circonstances l’interdiction de lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don ?
Je précise que le questionnement porte uniquement sur l’interdiction de lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don (Code civil, article 311-19). Je n’ai en effet aucun doute sur la nécessité de maintenir l’interdiction de contestation de la filiation pour les enfants issus d’un don et qui ont une filiation établie avec leurs 2 parents (Code civil, article 311-20).
3. Réflexions durant le projet de loi bioéthique
En 2018, il y a eu les états généraux de la bioéthique mais sauf erreur de ma part, cette problématique n’a jamais été traitée (en tout cas, je n’ai rien vu de tel dans les comptes-rendus que j’ai consultés).
En 2019, il y a eu de nombreuses auditions au parlement et Mgr Pierre d’Ornellas en avait profité pour tenter une réflexion sur l’interdiction du lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu de son don.
4. Pourquoi la question ne se pose pas encore
Un argument pour rejeter la réflexion sur cette question serait de dire que cette interdiction du lien de filiation existe depuis 26 ans et qu’elle n’a jamais posé le moindre problème et qu’en conséquence, ce serait prendre un risque inutile que d’envisager de modifier une règle qui ne pose pas de problème.
Effectivement, cette interdiction de lien de filiation ne pose pour l’instant pas de problème mais rien ne dit qu’il en sera toujours de même dans le futur. Selon moi, la loi de bioéthique devrait anticiper les problèmes et non pas attendre que des problèmes surviennent pour démarrer une réflexion et trouver une solution.
Même si ceux-ci sont minoritaires, certaines personnes issues d’un don peuvent considérer le donneur comme leur père. Exemple avec le témoignage Healing from Donor Conception: My Story (traduction en français) qui raconte les démarches d’une femme issue d’un don qui a retrouvé le donneur qu’elle considère comme son père.
Ce n’est que depuis 2018 que des personnes issues d’un don en France commencent à retrouver des donneurs. Cependant, ces personnes ont toutes eu à la naissance une mère et un père. Si les parents sont toujours en vie, le lien de filiation ne peut pas être contesté par leur enfant. Le fait pour une personne d’avoir 2 parents a donc pour conséquence de rendre impossible d’établir un lien de filiation avec le donneur.
Concernant les donneurs, il s’agit systématiquement d’hommes en couple et ayant des enfants. Il est peu probable que la femme du donneur et ses enfants voient d’un bon oeil que leur père établisse un lien de filiation avec une personne issue de son don. C’est la raison pour laquelle, j’estime peu probable qu’un ancien donneur accepte d’établir un lien de filiation avec une personne issue de son don.
Si le problème doit se poser un jour, ce sera donc dans plusieurs années. Cette question pourrait principalement se poser pour les enfants n’ayant un lien de filiation qu’avec un seul parent et dont le donneur est célibataire sans enfant.
Précisons que le nombre de donneurs célibataires sans enfants est en augmentation et que certains n’hésitent pas à dire qu’ils souhaitent nouer des liens avec ces enfants et qu’ils aimeraient pouvoir leur transmettre leurs biens. On peut supposer que ces donneurs accepteraient un lien de filiation avec les enfants issus de leur don afin d’en faire leurs héritiers.
Ma réflexion m’a mené à envisager une situation particulière.
5. Situation particulière : Le donneur de spermatozoïdes aime et élève l’enfant comme le ferait un père
Dans d’autres pays, il est plusieurs fois arrivé qu’une femme célibataire ayant fait appel à une banque de sperme pour avoir un enfant, décide de réaliser un test ADN sur son enfant, ce qui lui a permis de retrouver le donneur. Après que la femme célibataire soit entrée en relation avec le donneur (qui était un homme célibataire), cela s’est rapidement transformé en relation amoureuse. Le donneur et la femme se sont mariés, et le donneur s’est mis à aimer et élever comme un père l’enfant issu de son don. La mère de l’enfant considère son mari comme le père de l’enfant. Enfin, l’enfant considère le donneur comme son père.
Si cette situation s’est déjà produite à l’étranger (exemple réel en Australie), il est possible qu’elle se produise également en France.
On pourrait cependant qu’il n’est pas utile de modifier la loi pour qu’un lien de filiation soit établi. En effet, il suffit juste de faire la demande de filiation sans mentionner que l’enfant a été conçu par AMP avec tiers donneur et que le père est le donneur. En effet, l’état civil n’a aucun moyen de savoir que l’enfant est issu d’un don de spermatozoïdes, ni de connaître l’identité du donneur.
—
Edit du 2 octobre 2020 : Nous sommes en 2020 et pourtant, certains hommes qui sont devenus les pères d’enfants issus d’une AMP avec tiers donneur, envisagent toujours des actions en désaveux de paternité (ce qui est légalement impossible).
Lien : https://www.alexia.fr/questions/302606/contestation-de-paternite.htm
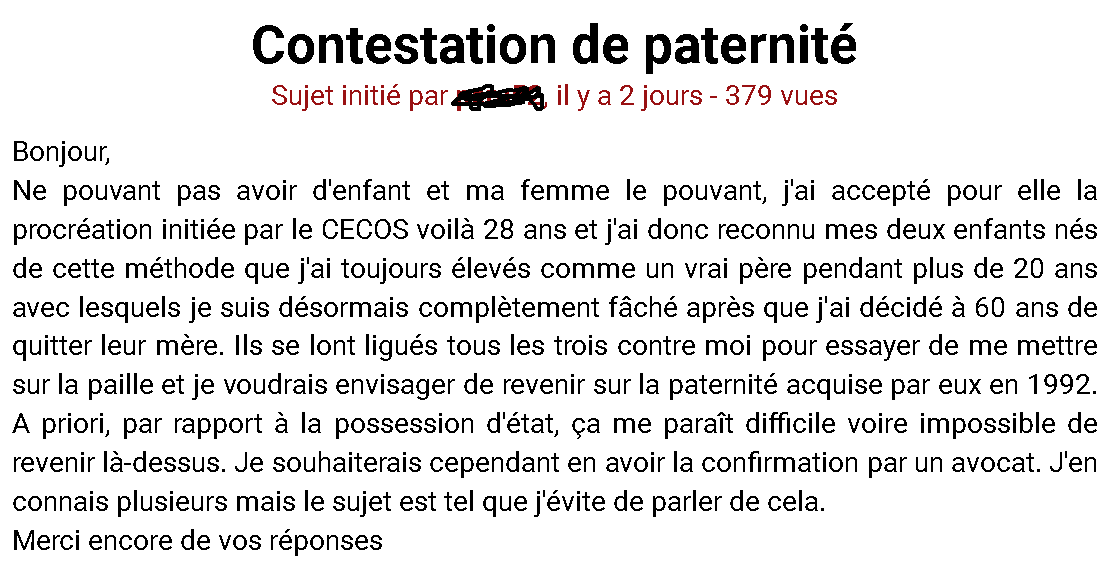
—
Edit du 17 octobre 2020 : Le 16 octobre 2020, la chaîne KTO a diffusé un débat entre la Agnès Firmin Le Bodo (députée de Seine-Maritime et présidente de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi bioéthique à l’Assemblée Nationale) et Mgr Pierre d’Ornellas (archevêque de Rennes, chargé des questions bioéthiques à la Conférence des Evêques de France).
Lien pour voir l’intégralité du débat : https://www.ktotv.com/video/00335477/2020-10-16-la-bioethique-en-debat
