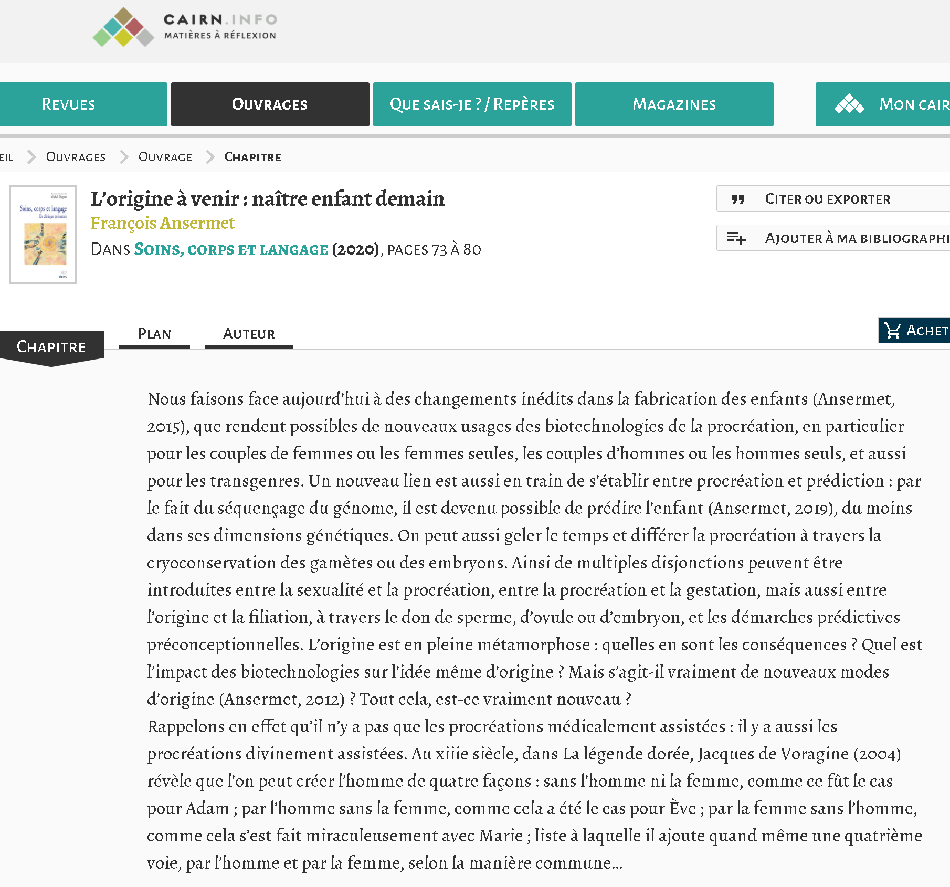Auteurs : Éva Weil
Date de mise en ligne : 2019
Résumé
L’enfant en vient maintenant à s’occuper du premier, du grand problème de la vie et se pose la question : d’où viennent les enfants ? […] Que l’enfant croisse dans le corps de la mère n’est manifestement pas une explication suffisante. Comment y entre-t‑il ? Qu’est ce qui déclenche son développement ? Que le père y soit pour quelque chose est vraisemblable ; il dit bien que l’enfant est aussi son enfant (Freud S., 1908c, p. 17 et 21).
Ces premières questions des enfants soulevées par la curiosité concernant le gros ventre de la mère, ou d’une autre femme, semblent être le moteur de toute recherche intellectuelle, qui va trouver là un lieu d’expérimentation sous couvert d’avancée scientifique persistant à l’âge adulte.
Mon expérience clinique, déjà longue, dans les services de médecine de la reproduction de l’APHP m’a amené à rencontrer des patients qui veulent un enfant et se voient confrontés à la nécessité de recourir à un don de gamètes, d’embryon et peut-être bientôt à une greffe d’utérus. Ils nous confrontent à la question, posée plus haut et toujours actuelle : « d’où viennent les enfants ? » qui concerne aussi les patients fertiles faisant don de leurs gamètes, de leurs embryons cryoconservés. Les équipes médicales demandent à ces patients fertiles, sous couvert des lois et circulaires, d’exposer leurs motivations, en particulier, la nature de ce qui est donné. Ceci laissera entier, pour tous, le mystère de la création de l’humain.
Un couple peut demander un don de gamètes, nécessairement anonyme, en France actuellement, quelquefois, non anonyme dans certains pays d’Europe tout près, et aux États-Unis…
Citation : Weil Éva, « Maternité par procréation médicalement assistée : mais d’où viennent les enfants ? », dans : Hélène Parat éd., Maternités. Paris cedex 14, Presses Universitaires de France, « Débats en psychanalyse », 2019, p. 115-129. URL : https://www.cairn.info/maternites–9782130786986-page-115.htm
Lien du document : : https://www.cairn.info/maternites–9782130786986-page-115.htm
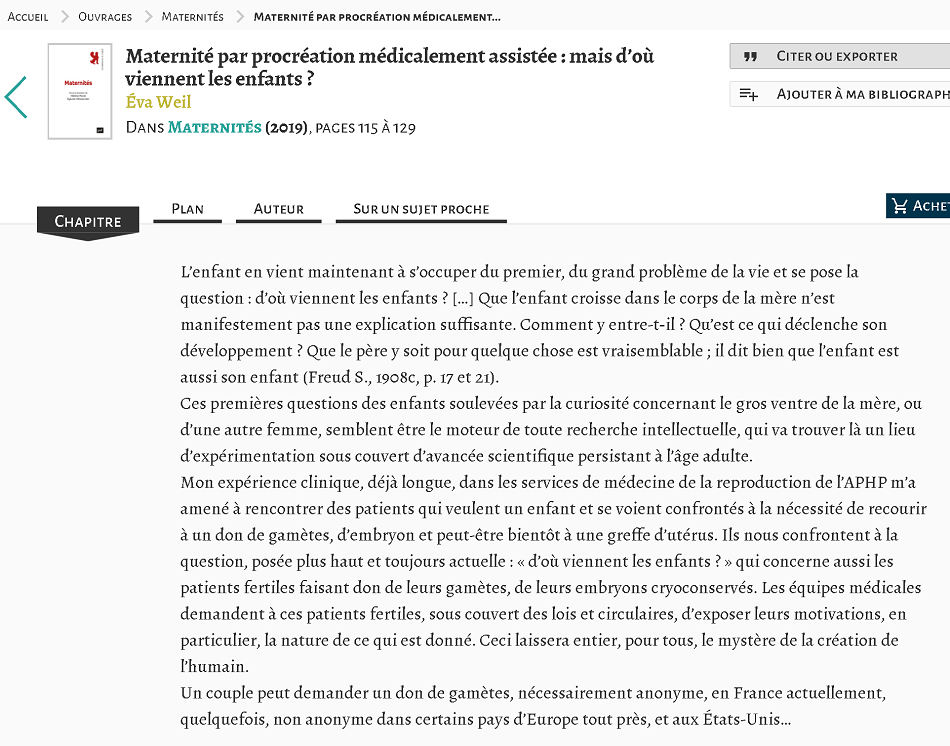

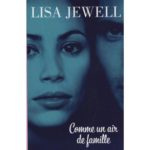 Lydia est une richissime scientifique solitaire de vingt-neuf ans, Robyn une belle et prometteuse étudiante en médecine et Dean un très jeune père, déjà veuf et un peu dépassé. Ils n’ont a priori rien en commun, si ce n’est… leurs gènes ! Issus du même don de sperme, ils ont grandi se croyant seuls au monde et se découvrent soudain une fratrie. Chacun, à un tournant de sa vie, va se plonger dans une bouleversante quête d’identité. Un donneur de sperme, sur le point de mourir, souhaite savoir ce que sont devenus les enfants issus de ses dons.
Lydia est une richissime scientifique solitaire de vingt-neuf ans, Robyn une belle et prometteuse étudiante en médecine et Dean un très jeune père, déjà veuf et un peu dépassé. Ils n’ont a priori rien en commun, si ce n’est… leurs gènes ! Issus du même don de sperme, ils ont grandi se croyant seuls au monde et se découvrent soudain une fratrie. Chacun, à un tournant de sa vie, va se plonger dans une bouleversante quête d’identité. Un donneur de sperme, sur le point de mourir, souhaite savoir ce que sont devenus les enfants issus de ses dons.
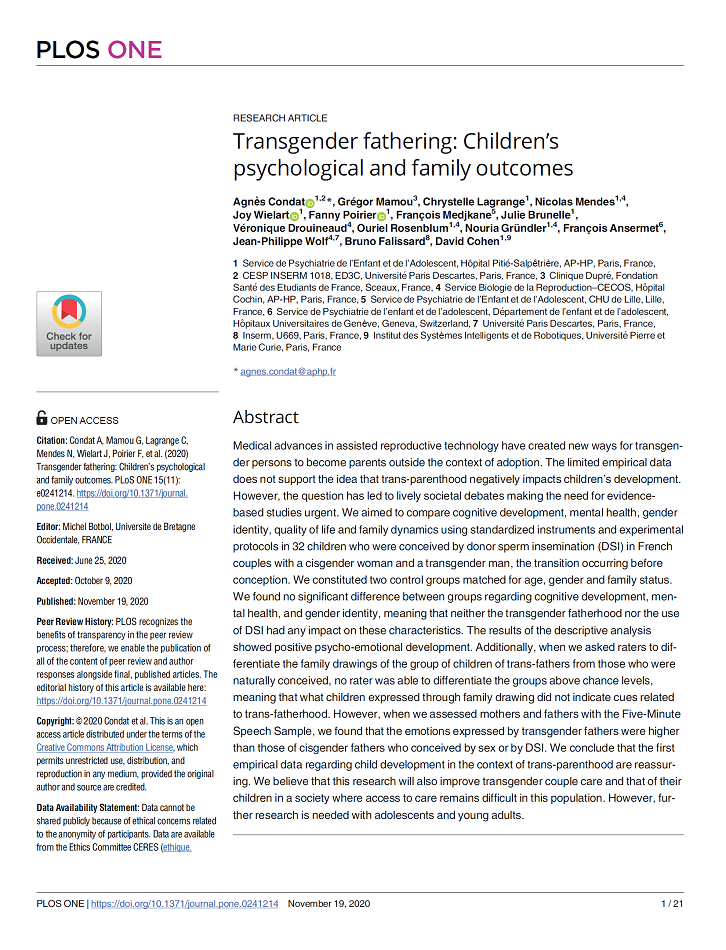
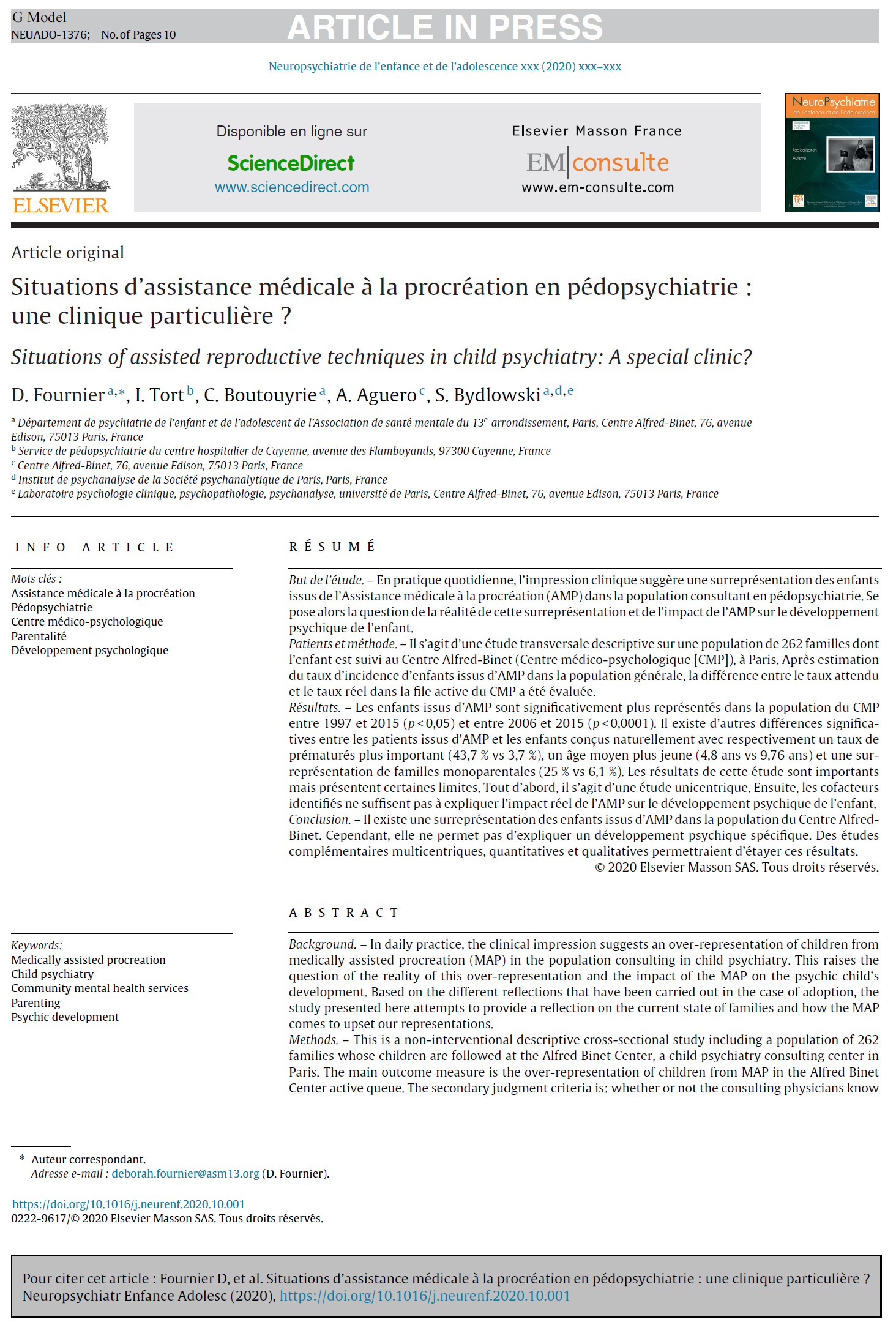
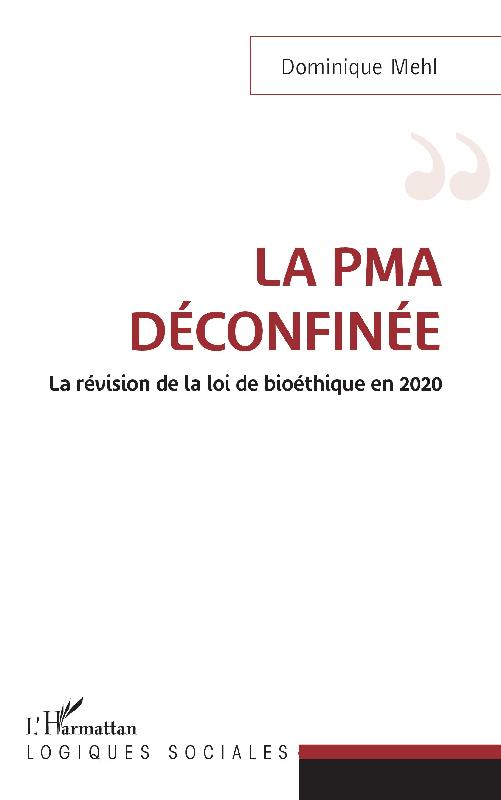 1994 : la première loi de bioéthique réserve l’accès à la procréation médicalement assistée aux seuls couples hétérosexuels infertiles. 2020 : la loi revisitée accepte cette fois les couples lesbiens et les femmes seules. Désormais, la PMA est déconfinée : elle s’étend à de nouvelles populations, valide l’homoparenté et la maternité solo. La nouvelle loi légitime aussi l’accès aux origines et l’autoconservation des ovocytes. C’est un véritable tournant sociétal même si la PMA qui exclut la gestation pour autrui n’est pas totalement libérée des carcans qui l’enserraient. Ces avancées ont été obtenues au terme de longues années de controverses et de combats qui ont mobilisé les médecins, les législateurs et les citoyens.
1994 : la première loi de bioéthique réserve l’accès à la procréation médicalement assistée aux seuls couples hétérosexuels infertiles. 2020 : la loi revisitée accepte cette fois les couples lesbiens et les femmes seules. Désormais, la PMA est déconfinée : elle s’étend à de nouvelles populations, valide l’homoparenté et la maternité solo. La nouvelle loi légitime aussi l’accès aux origines et l’autoconservation des ovocytes. C’est un véritable tournant sociétal même si la PMA qui exclut la gestation pour autrui n’est pas totalement libérée des carcans qui l’enserraient. Ces avancées ont été obtenues au terme de longues années de controverses et de combats qui ont mobilisé les médecins, les législateurs et les citoyens.
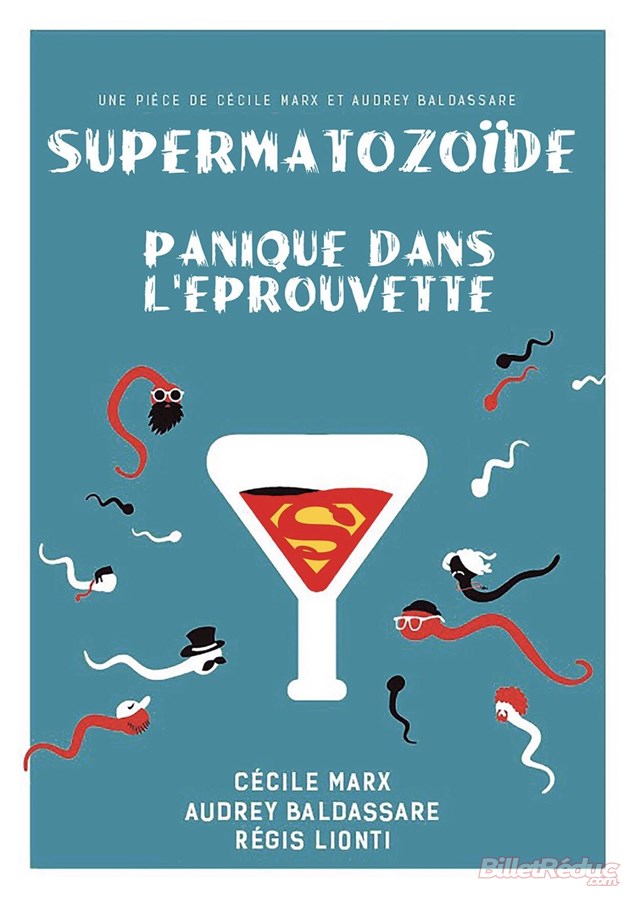
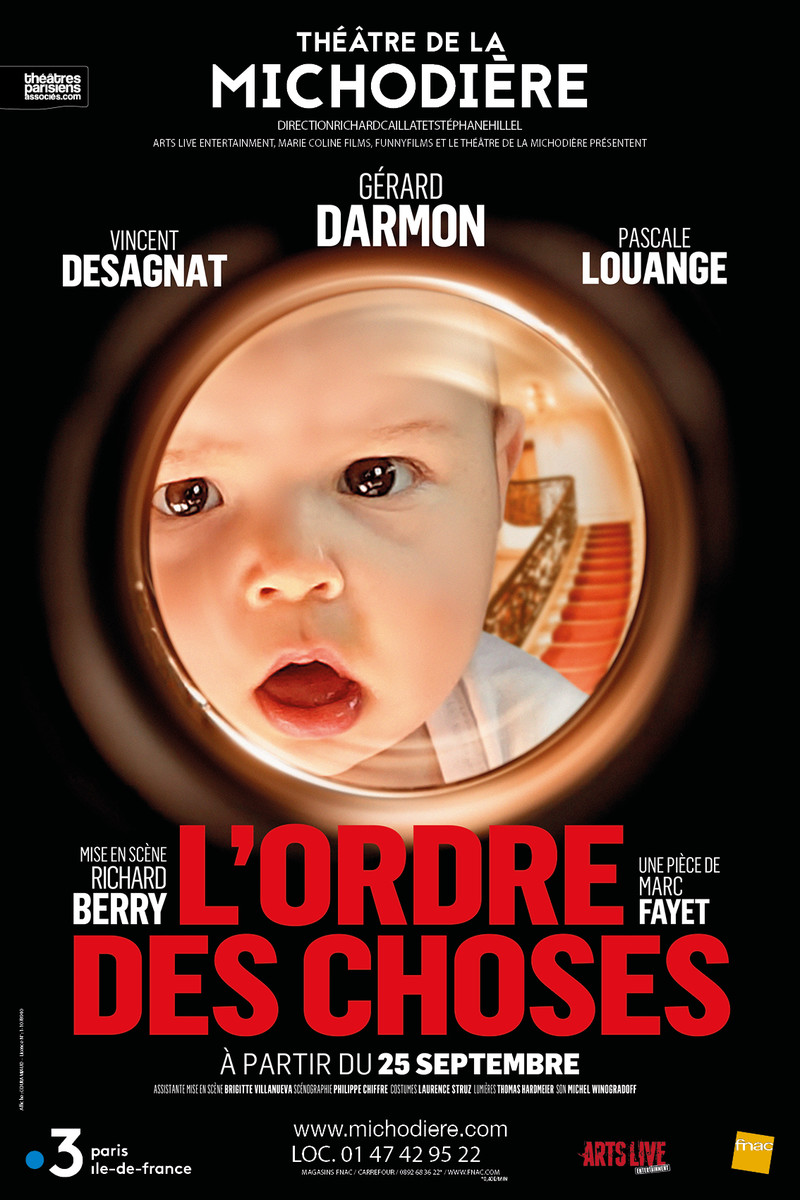
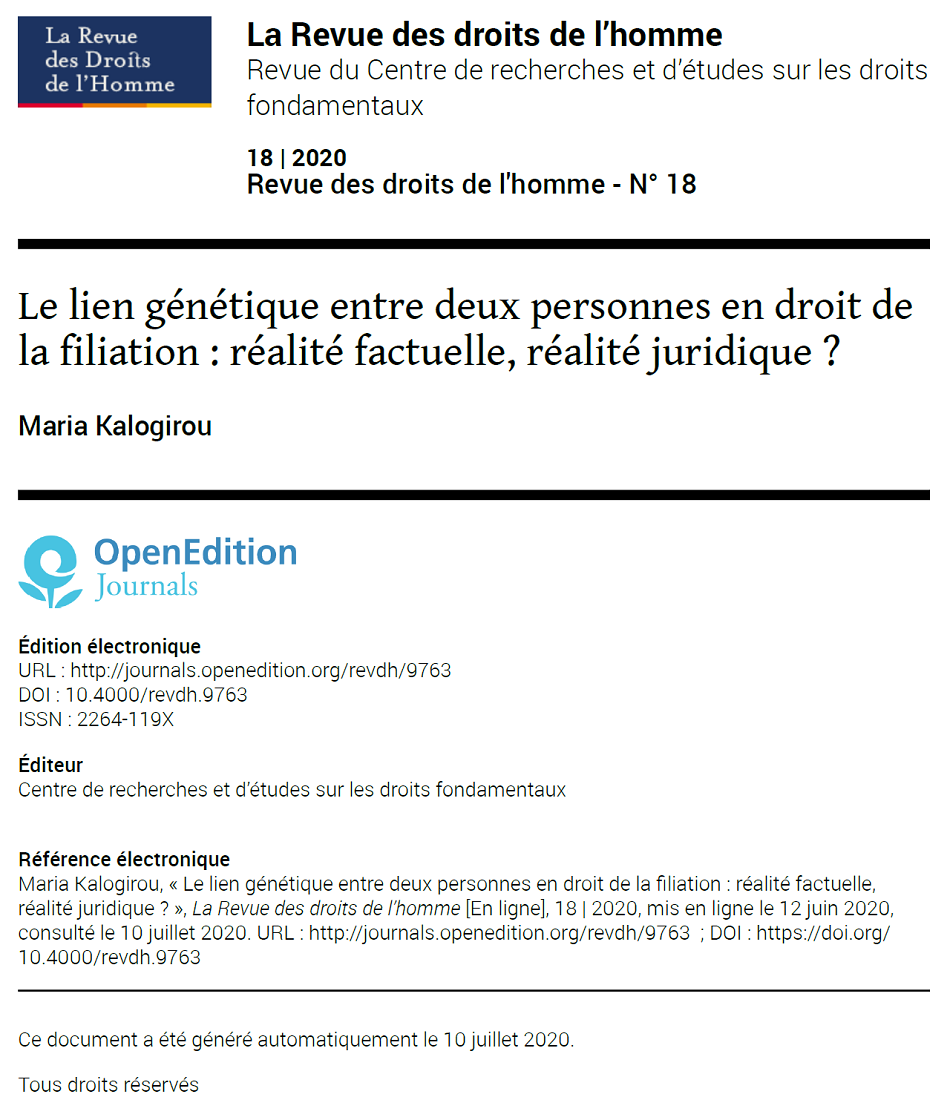
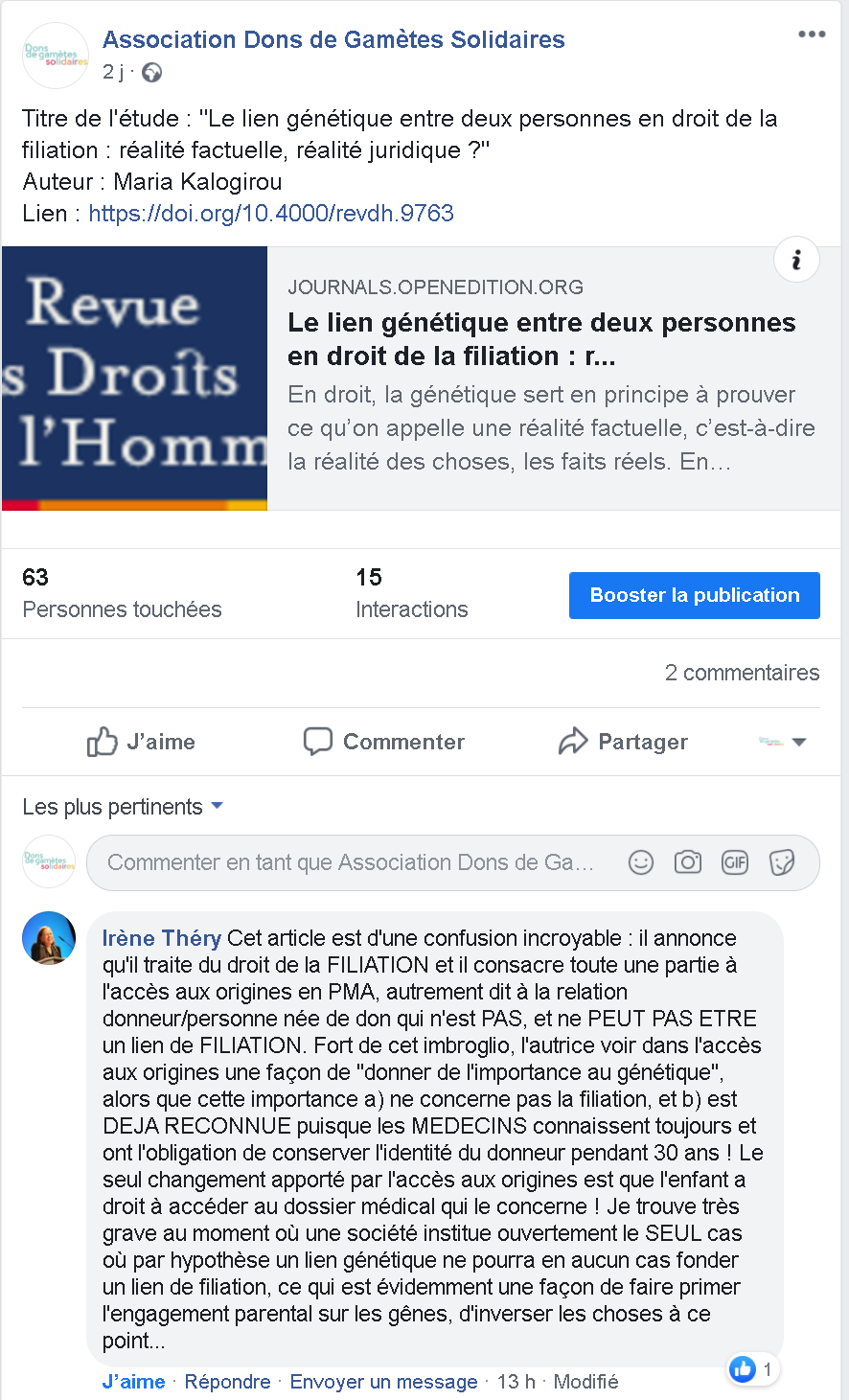
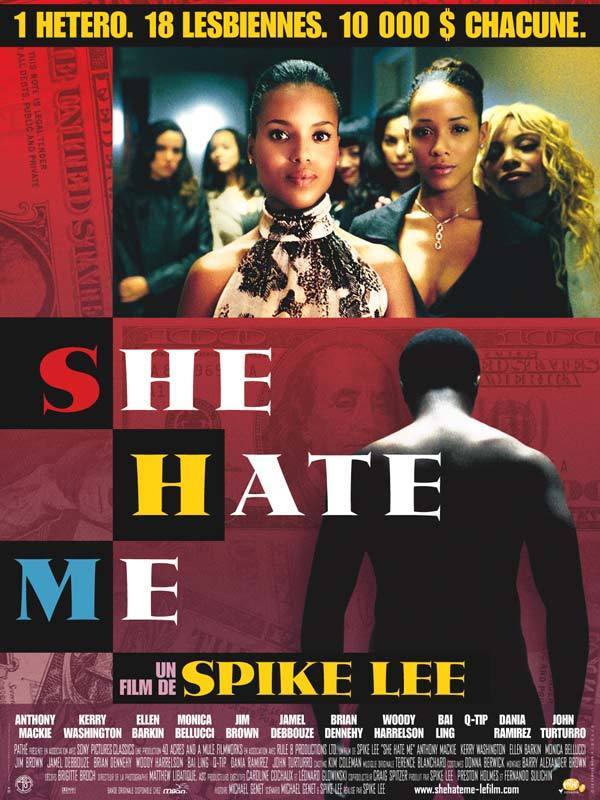 Diplômé de Harvard, John Henry « Jack » Armstrong est cadre supérieur dans une entreprise de biotechnologie. Mais lorsqu’il dénonce les malversations financières de ses patrons à la Commission des Opérations de Bourse, il est aussitôt licencié. Désormais considéré comme un mouchard, il est aux abois.
Diplômé de Harvard, John Henry « Jack » Armstrong est cadre supérieur dans une entreprise de biotechnologie. Mais lorsqu’il dénonce les malversations financières de ses patrons à la Commission des Opérations de Bourse, il est aussitôt licencié. Désormais considéré comme un mouchard, il est aux abois.