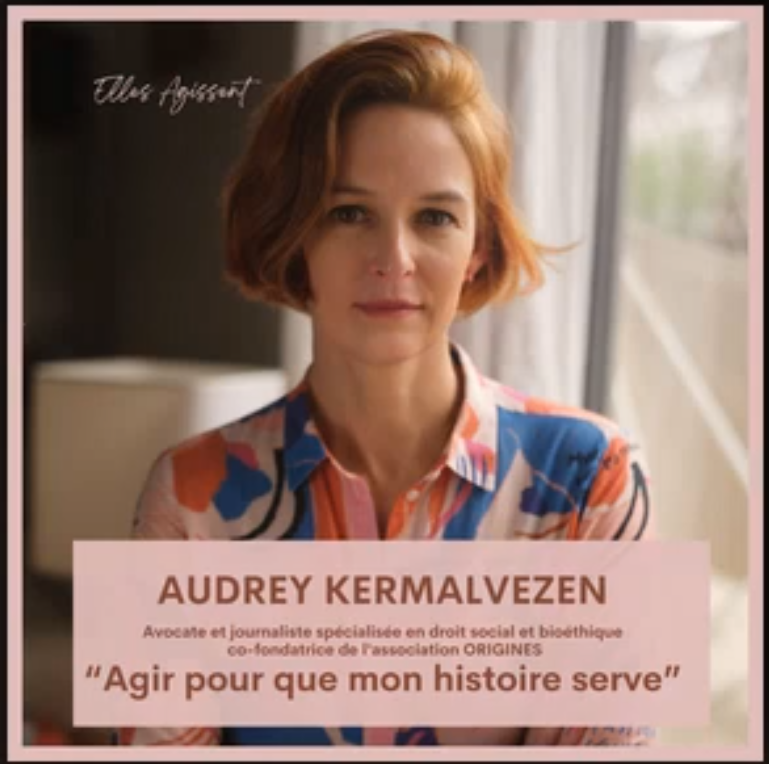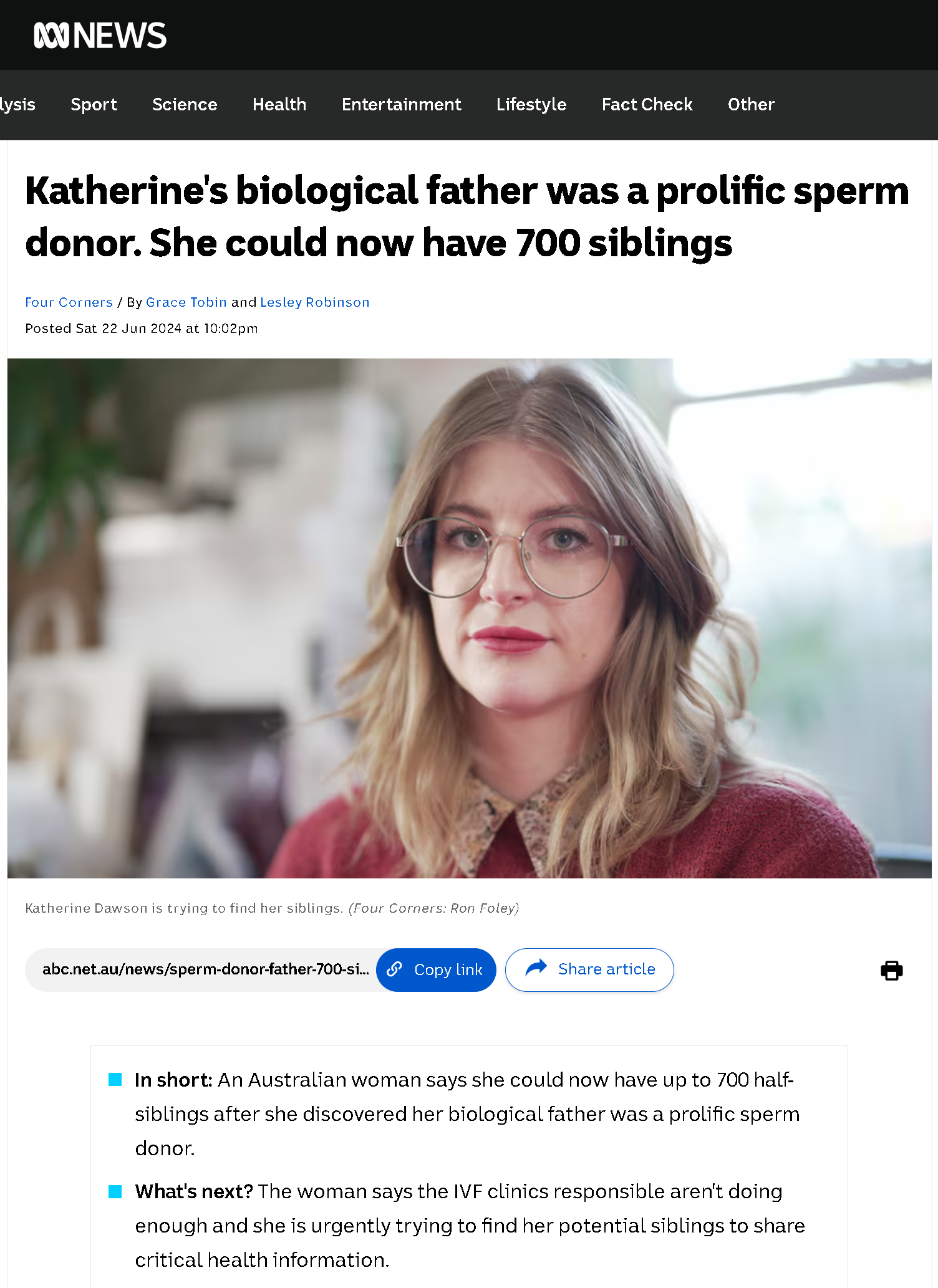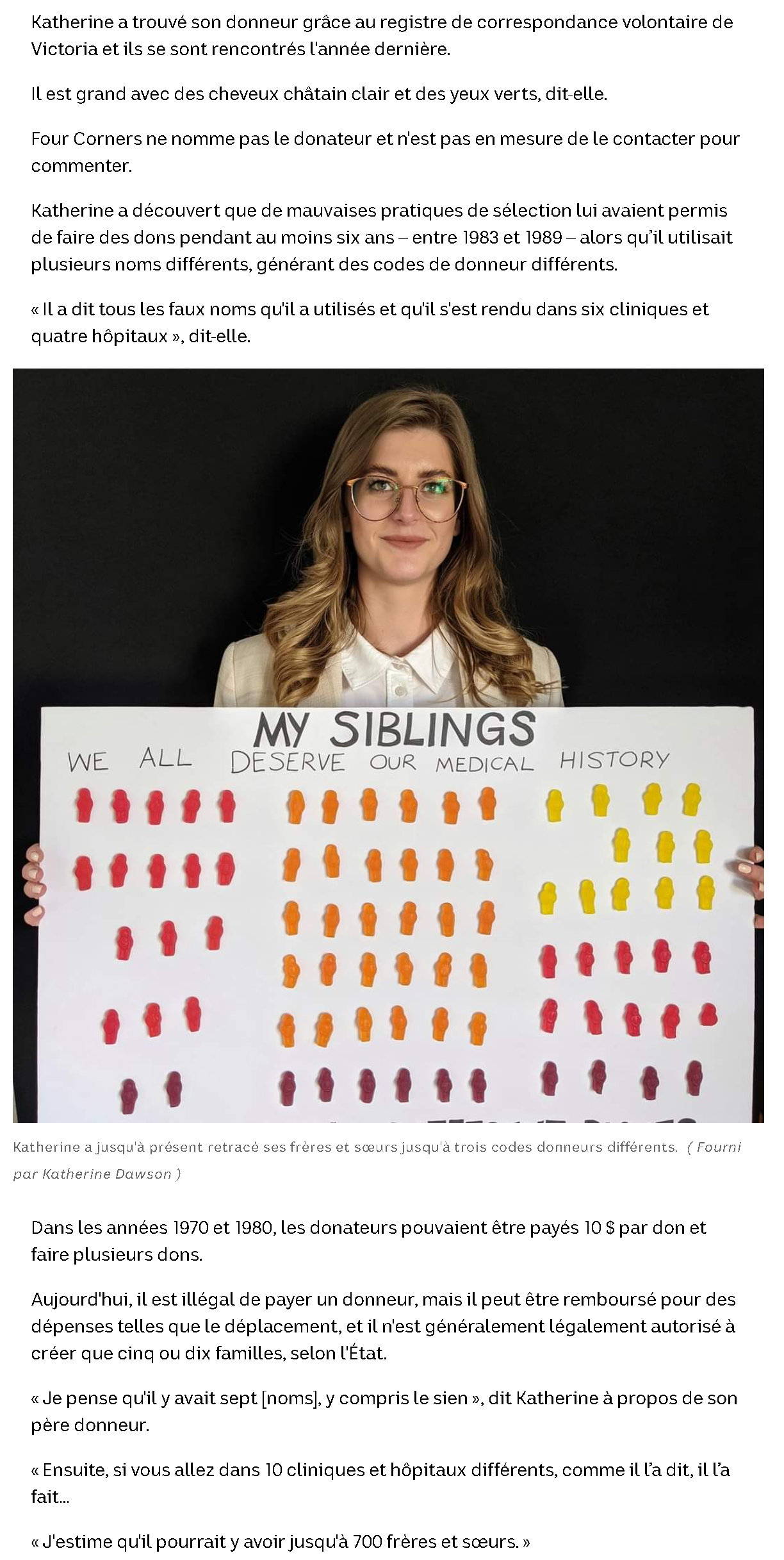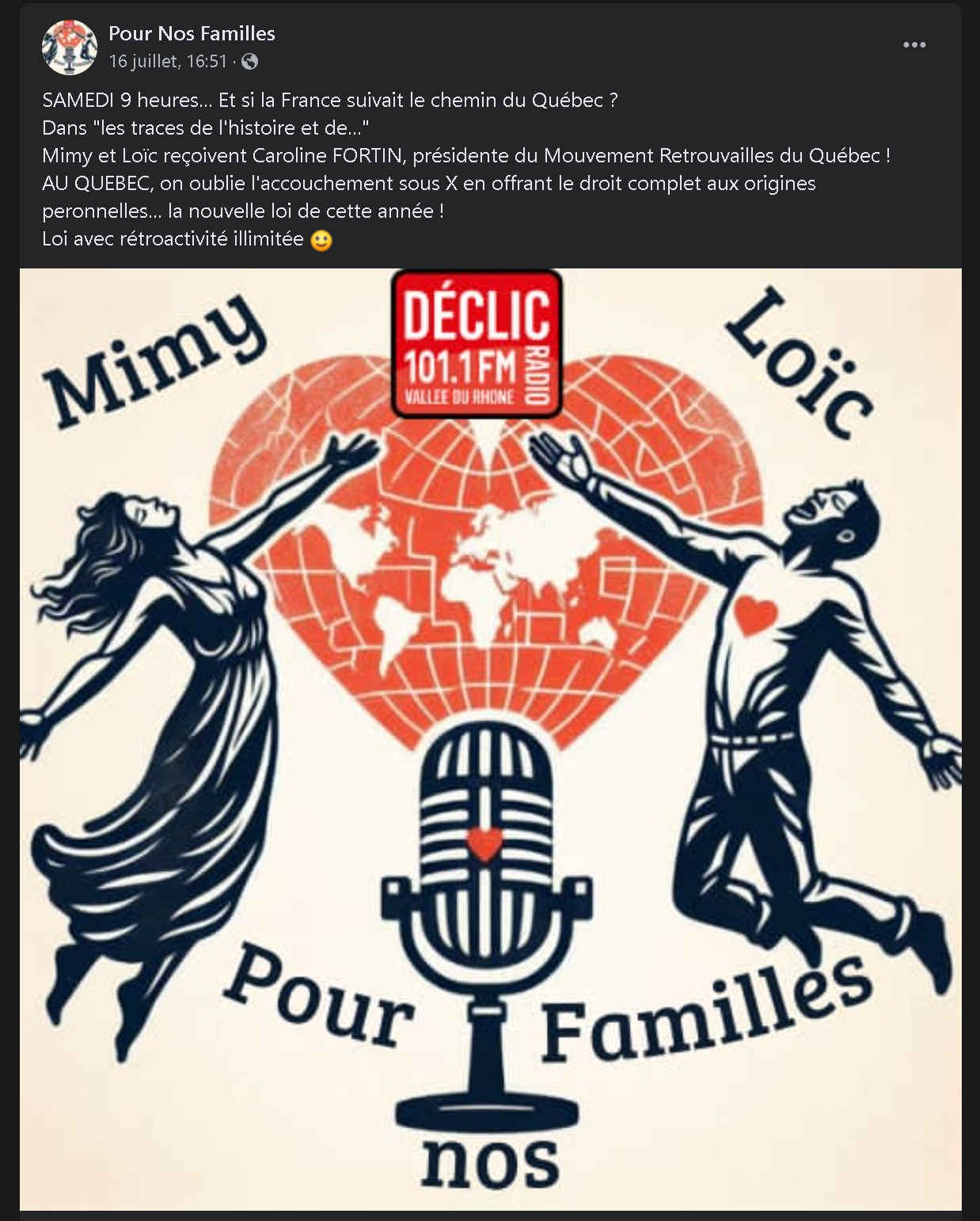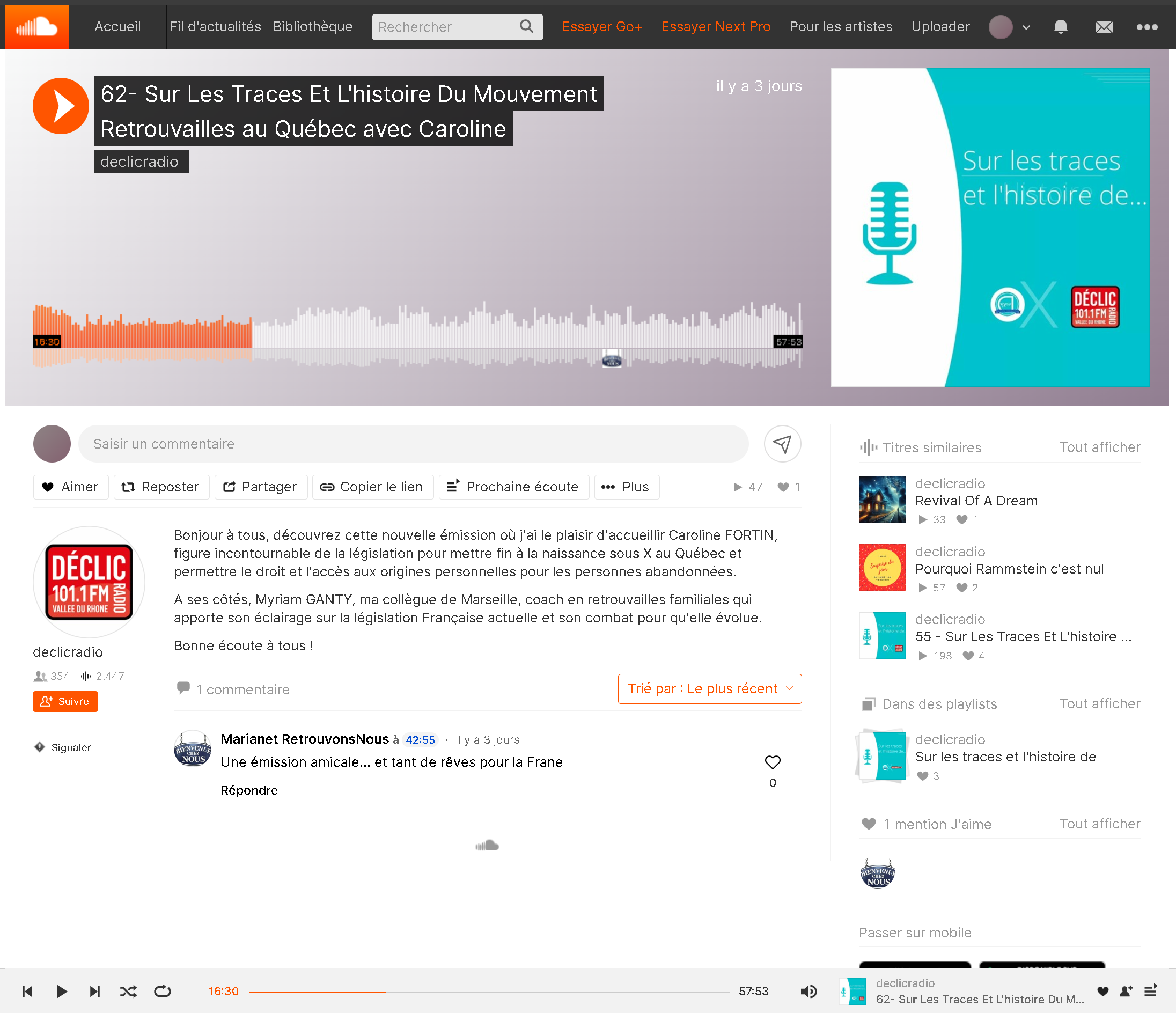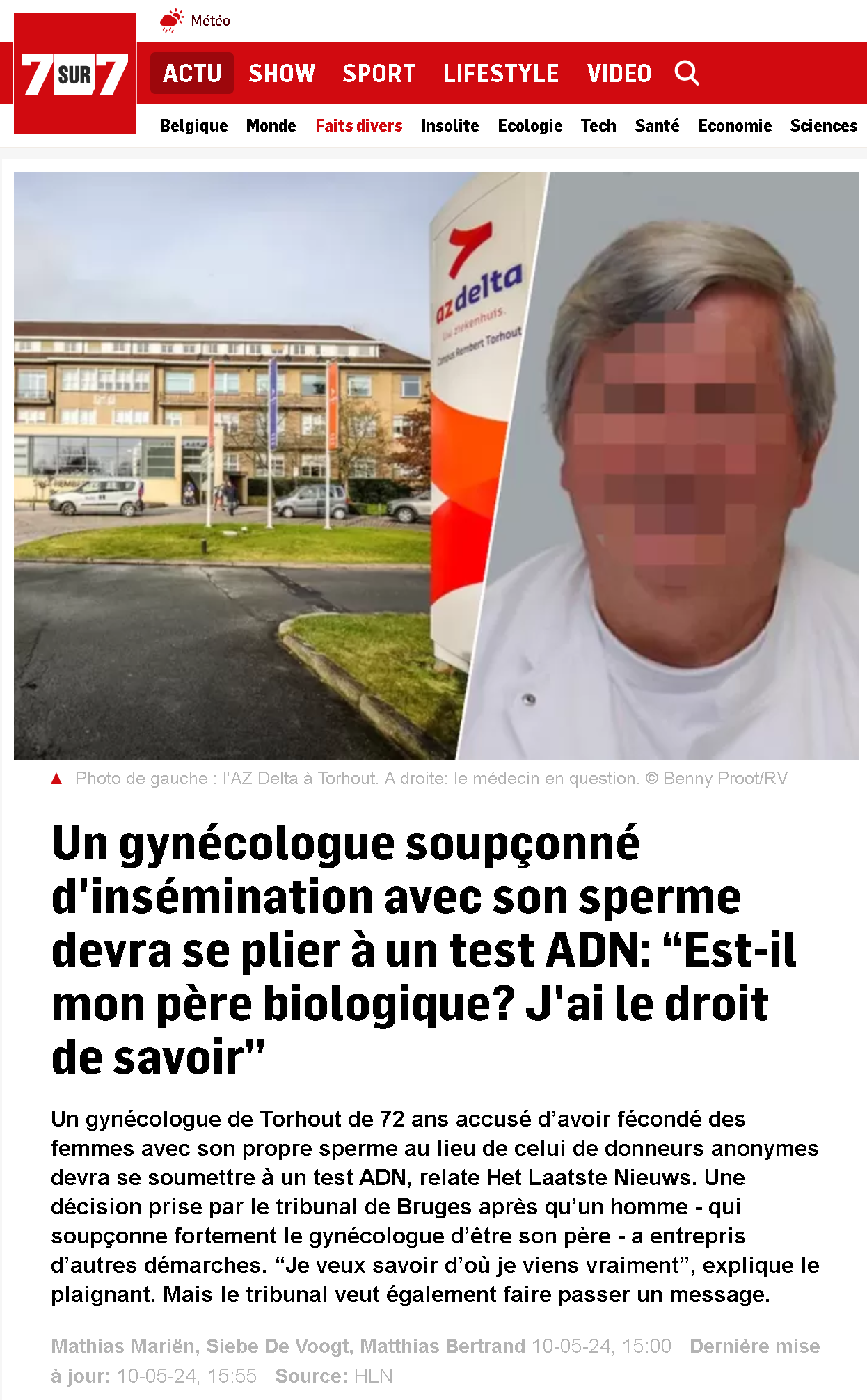Conseil d’État
N° 495138
ECLI:FR:CECHS:2024:495138.20240725
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
M. Bertrand Dacosta, président
M. Philippe Bachschmidt, rapporteur
M. Laurent Domingo, rapporteur public
BARDOUL, avocats
Lecture du jeudi 25 juillet 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A… B…, à l’appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 juin 2023 par laquelle la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la protection aux données des tiers donneurs (CAPADD) a rejeté sa demande relative à l’accès aux données identifiantes et non-identifiantes de son tiers donneur et à ce qu’il soit enjoint à la CAPADD de lui fournir ces données, a produit un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023 au greffe de ce tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par un jugement n° 2325233 du 14 juin 2024, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Paris, avant qu’il ne soit statué sur la requête de Mme B…, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du VIII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et un nouveau mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, Mme B… soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent le droit au respect de la vie privée, le droit de mener une vie familiale normale, le principe d’égalité devant la loi et l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités soutient que les conditions posées par les articles 23-2 et 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 juillet 2024, l’association PMAnonyme demande au Conseil d’Etat de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B… au Conseil constitutionnel.
La question prioritaire de constitutionnalité été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– le code de la santé publique ;
– la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;
– le décret n° 2023-785 du 16 août 2023 ;
– la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1052 QPC du 9 juin 2023 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de Mme B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juillet 2024, présentée par Mme B… ;
Sur l’intervention de l’association PMAnonyme :
1. Eu égard au caractère accessoire, par rapport au litige principal, d’une question prioritaire de constitutionnalité, une intervention, aussi bien en demande qu’en défense, n’est recevable à l’appui du mémoire par lequel il est demandé au Conseil d’Etat de renvoyer une telle question au Conseil constitutionnel qu’à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l’action principale. L’association PMAnonyme se borne à intervenir devant le Conseil d’Etat au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B… sans être intervenue au soutien de sa demande devant le tribunal administratif tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la protection aux données des tiers donneurs (CAPADD) a rejeté la demande de Mme B… relative à l’accès aux données identifiantes et non-identifiantes de son tiers donneur. Son intervention est, par suite, irrecevable.
Sur la question prioritaire de constitutionalité :
2. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. L’article 5 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a inséré dans le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, relatif à l’assistance médicale à la procréation, un chapitre III portant sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. Alors que, sous le régime antérieur, les personnes conçues par assistance médicale à la procréation n’avaient pas accès à de telles données, l’article L. 2143-2 du code de la santé publique dispose désormais que : » Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l’article L. 2143-3./ Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil (…) « . Aux termes de l’article L. 2143-3 du même code, les données non identifiantes du donneur sont l’âge, l’état général, les caractéristiques physiques, la situation familiale et professionnelle, le pays de naissance et les motivations du don.
4. Il résulte des dispositions transitoires prévues par l’article 5 de la loi du 2 août 2021 que l’obligation pour toute personne souhaitant procéder à un don de gamètes ou proposer un embryon à l’accueil de consentir préalablement à la communication de son identité et de ses données non identifiantes entre en vigueur le 1er septembre 2022. De plus, aux termes du C du VII de l’article 5 : » A compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don « . Aux termes du D du VII du même article : » A la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VII, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi « . Parallèlement, le A du VIII du même article dispose que le droit d’accès aux origines » s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article « . Cette date a été fixée au 31 mars 2025 par le décret du 16 août 2023 fixant la date mentionnée au C du VII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
5. Le législateur a toutefois entendu ouvrir aux tiers donneurs qui ont consenti un don de gamètes sous l’empire du régime antérieur la possibilité de lever l’anonymat au bénéfice des personnes nées de leur don. Ainsi, le D du VIII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 dispose que : » Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur « . Le B du VIII de ce même article dispose que les tiers donneurs dont les embryons ou gamètes sont utilisés jusqu’à la date prévue par décret au C du VII du même article peuvent manifester auprès de la CAPADD leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes détenues par les centres de dons de gamètes ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes. Le E du VIII dispose enfin que la CAPADD fait droit » aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du D du présent VIII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B « .
6. Par ailleurs, il résulte des dispositions du 5° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique que la CAPADD est chargée » de recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143 4 « . De plus, aux termes du 6° du même article, la CAPADD est également chargée » de contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine. « .
7. Il résulte de la lecture combinée des dispositions du 6° de l’article L. 2143-2 du code de la santé publique et du VIII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021, citées aux points 5 et 6, que la CAPADD peut recontacter les tiers donneurs ayant réalisé un don de gamètes sous le régime juridique antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 afin de solliciter leur consentement à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes à la personne majeure née de leur don, lorsque celle-ci en fait la demande. Lorsque le tiers donneur est décédé au moment de la demande, la CAPADD, faute de pouvoir recueillir le consentement de l’intéressé ne peut, par conséquent, y donner suite.
8. La requérante soutient que les dispositions contestées sont contraires au droit au respect de la vie privée, au droit de mener une vie familiale normale, au principe d’égalité devant la loi et à l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, en ce qu’elles ne prévoient pas un régime de droit d’accès aux origines personnelles pour les personnes nées d’un tiers donneur décédé au jour de la demande formée auprès de la CAPADD, y compris pour l’accès aux données non identifiantes.
9. Les dispositions contestées visent à garantir un équilibre entre le droit au respect de la vie privée du tiers donneur ayant réalisé un don en vertu du régime juridique antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021, lequel garantissait son anonymat par l’interdiction absolue de communiquer à la personne née du don tant son identité que ses données dites non identifiantes, y compris après son décès, et l’accès, dans la mesure du possible et par des mesures appropriées, de l’enfant issu du don à la connaissance de ses origines personnelles, afin de ne pas porter atteinte aux situations légalement acquises ou remettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l’empire de textes antérieurs. La circonstance que le tiers donneur soit décédé au moment de la demande formée par l’enfant né du don auprès de la CAPADD n’affecte pas l’équilibre recherché par le législateur, lequel repose sur l’expression du consentement du tiers donneur à la communication de son identité et de ses données non identifiantes. Les dispositions en cause, justifiées par la protection de la vie privée du donneur et, après son décès, de celle de sa famille, ne portent donc pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ou au droit de mener une vie familiale normale de la personne née du don, non plus qu’à l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. En l’espèce, les personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à une époque où la loi garantissait l’anonymat du donneur ne sont pas dans la même situation que les personnes conçues depuis l’entrée en vigueur de loi du 2 août 2021 et la différence de traitement qui résulte des dispositions critiquées est en rapport direct avec l’objet de la loi. Il en va de même en ce qui concerne la différence de traitement entre les personnes nées d’un don antérieur au 1er septembre 2022 selon que le donneur est ou non décédé.
10. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n’y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
————–
Article 1er : L’intervention de l’association PMAnonyme n’est pas admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B….
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à l’association PMAnonyme et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet